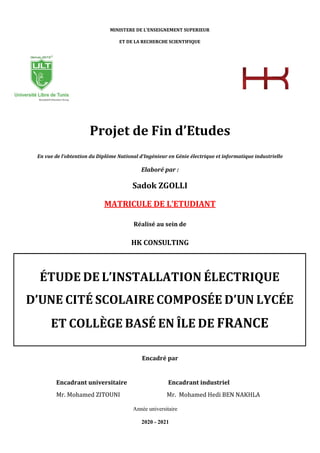
Rapport Stage PFE Bureau D'étude Electricité : ÉTUDE DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE D’UNE CITÉ SCOLAIRE COMPOSÉE D’UN LYCÉE ET COLLÈGE BASÉ EN ÎLE DE FRANCE
- 1. Année universitaire 2020 - 2021 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Institut Supérieur Polytechnique Privé Projet de Fin d’Etudes En vue de l’obtention du Diplôme National d’Ingénieur en Génie électrique et informatique industrielle Elaboré par : Sadok ZGOLLI MATRICULE DE L’ETUDIANT Réalisé au sein de HK CONSULTING Encadré par Encadrant universitaire Encadrant industriel Mr. Mohamed ZITOUNI Mr. Mohamed Hedi BEN NAKHLA ÉTUDE DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE D’UNE CITÉ SCOLAIRE COMPOSÉE D’UN LYCÉE ET COLLÈGE BASÉ EN ÎLE DE FRANCE
- 2. i Dédicaces Je dédie ce modeste travail : A mes chers parents qui ont tant donné. A mon cher père Ahmed pour son immense soutien et ses sacrifices A ma chère mère Dalanda pour son grand amour ses prières. Qu’ils acceptent ici l’hommage de ma gratitude, qui, si grande qu’elle puisse Être, ne sera jamais à la hauteur de leur tendresse et leur dévouement. A mon cher frère Mohamed. Vous aviez toujours cru en moi, et c’est dans votre présence que j’ai puisé la Volonté de continuer. A toute ma famille. A toutes mes enseignantes et à tous mes enseignants. A toutes mes chères amies et à tous mes chers amis, Amen Allah, Bayrem, Mhamed, Amir, Slim, Seif, Houssem A tous ceux que j’aime. A tous ceux qui m’aiment. A tous ceux qui m’ont aidé de près ou de loin.
- 3. ii Remerciements Au terme de mon projet de fin d’études, j’exprime ma profonde gratitude à Monsieur le Chef département Slim Mohamed Aymen et monsieur le directeur des études Touati Oussama à l’Université Libre de Tunis tout le cadre administratif et professoral pour leurs efforts considérables, spécialement le département Génie électrique et Informatique Industriel. Ma gratitude s’adresse également à mon professeur Mr Mohamed Zitouni pour son encadrement pédagogique très consistant ainsi que pour l’intérêt avec lequel il a suivi la progression de mon travail, pour ses conseils efficients, ses judicieuses directives et pour les moyens qu’il a mis à ma disposition pour la réussite de ce travail tout au long de ma période de projet. J’adresse, aussi mes sincères considérations à Mr Ben Nakhla Hedi, Mr Khaldi Mohamed Khalil, Ouertani Mohamed Amine mes parrains au sein de l’entreprise, pour m’avoir donné l’opportunité de passer ce stage dans les meilleures conditions de professionnalisme, matérielles et morales, et pour leurs directives à chaque fois qu’ils étaient sollicité. Je remercie, également les membres de jury d’avoir accepté d’évaluer mon travail. Mes sincères remerciements vont aussi à tout le personnel du bureau HK Consulting, pour leur soutien et leur encouragement. Vers la fin, il m’est très agréable d’exprimer toutes ma reconnaissance pour ceux qui m'ont entouré de près ou de loin pendant mes années études de pour leur soutien, leur aide et, surtout, pour leur sympathie. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance et mon profond respect.
- 4. iii Table des matières Dédicaces................................................................................................................................i Remerciements ......................................................................................................................ii Table des matières ................................................................................................................iii Liste des figures....................................................................................................................xi Liste des tableaux ................................................................................................................ xv Liste des abréviations .........................................................................................................xvi Présentation de l’entreprise ................................................................................................... 1 Introduction générale............................................................................................................. 3 CHAPITRE I. INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET............................................................................ 5 I.1 Introduction.................................................................................................................................... 5 I.2 Généralité sur les bureaux d’études................................................................................................ 5 I.3 Le besoin ........................................................................................................................................ 6 I.4 Les phases d’un projet.................................................................................................................... 6 I.4.1 Etude d’esquisse - ESQ......................................................................................................... 6 I.4.2 Avant-projet sommaire – APS.............................................................................................. 6 I.4.3 Avant-projet détaillée – APD................................................................................................ 7 I.4.4 Dossier d’appel d’offres – DAO........................................................................................... 7 I.4.5 Dossier d’exécution .............................................................................................................. 7 I.5 BIM (Building Information Modeling) .......................................................................................... 7 I.5.1 Contexte................................................................................................................................ 7 I.5.2 La modélisation..................................................................................................................... 8 I.5.3 Le BIM à travers le cycle de vie d’un bâtiment.................................................................... 9 I.5.3.1 Du programme à la déconstruction.............................................................................. 9 I.5.4 La Charte BIM : stratégie générale de la maîtrise d’ouvrage.............................................. 10 I.5.5 Le Cahier des Charges BIM : besoins spécifiques de la maîtrise d’ouvrage sur un projet particulier .......................................................................................................................................... 10 I.5.6 La Convention BIM : document fédérateur de la maîtrise d’œuvre du projet .................... 11 I.5.7 Conclusion .......................................................................................................................... 11
- 5. iv I.6 Cadre du projet............................................................................................................................. 12 I.6.1 Contexte.............................................................................................................................. 12 I.6.2 Cité scolaire de Saint Georges de l’Oyapock – Fiche Projet .............................................. 12 I.6.2.1 1er groupement de bâtiments...................................................................................... 13 I.6.2.2 2eme groupement de bâtiments................................................................................. 14 I.6.2.3 Depuis un poste EDF en limite de propriété : ........................................................... 14 I.6.2.4 Classification des bâtiments ...................................................................................... 14 I.6.2.4.1 Définitions de bases............................................................................................................... 14 I.6.2.4.2 Les bâtiments recevant du public (ERP)................................................................................ 15 I.6.2.4.3 Les catégories des ERP.......................................................................................................... 15 I.6.2.4.4 Les types des ERP ................................................................................................................. 15 I.6.2.4.5 Cité scolaire........................................................................................................................... 16 I.6.3 Plan masse .......................................................................................................................... 17 I.6.4 Travail demandé ................................................................................................................. 18 I.7 Conclusion.................................................................................................................................... 18 CHAPITRE II. ETUDE D’ECLAIREMENT................................................................................................ 19 II.1 Introduction.................................................................................................................................. 19 II.2 Notions de bases........................................................................................................................... 19 II.2.1 Composition de la lumière.................................................................................................. 19 II.2.2 La vision ............................................................................................................................. 19 II.3 Les grandeurs photométriques...................................................................................................... 20 II.3.1 Le flux lumineux en lumens (Lm) ...................................................................................... 20 II.3.2 L’intensité lumineuse en candela (Cd)................................................................................ 20 II.3.3 L’éclairement en Lux (Lx).................................................................................................. 21 II.3.4 La luminance en candela/m² (Cd/m²).................................................................................. 21 II.4 Caractéristiques lumineuse et électriques des luminaires............................................................. 22 II.4.1 Indice de rendue de couleur (IRC)...................................................................................... 22 II.4.2 Température de couleur (CCT) en degrés Kelvin (K)......................................................... 23 II.4.3 Courbe photométrique ........................................................................................................ 24 II.4.4 Notion d’éblouissement ...................................................................................................... 25 II.4.5 Efficacité lumineuse en (lm/w)........................................................................................... 26 II.4.6 Duré de vie moyenne .......................................................................................................... 26 II.4.7 Classe des luminaires.......................................................................................................... 27
- 6. v II.4.8 L’indice de protection IP .................................................................................................... 28 II.4.9 L’indice de protection IK.................................................................................................... 29 II.5 Eclairage LED.............................................................................................................................. 30 II.5.1 Définition............................................................................................................................ 30 II.5.2 Types des LED.................................................................................................................... 30 II.5.2.1 La LED SMD (Surface Mounting Device)................................................................ 30 II.5.2.2 La LED High-Power ................................................................................................. 30 II.5.2.3 La LED COB............................................................................................................. 31 II.5.3 Avantages ........................................................................................................................... 31 II.5.3.1 Consommation électrique faible................................................................................ 31 II.5.3.2 Coût de maintenance réduit....................................................................................... 31 II.5.3.3 Temps de réchauffement ........................................................................................... 31 II.5.3.4 Impact environnemental............................................................................................ 32 II.5.4 Système de contrôle d’éclairage ......................................................................................... 32 II.5.5 Fonctionnement .................................................................................................................. 32 II.5.5.1 Protocole DALI......................................................................................................... 33 II.5.5.2 Fonctionnalités .......................................................................................................... 33 II.6 Etude de l’éclairage intérieur........................................................................................................ 35 II.6.1 Niveau d’éclairement (E).................................................................................................... 35 II.6.2 Caractéristiques du local..................................................................................................... 35 II.6.3 Les facteurs de réflexion..................................................................................................... 36 II.6.4 Le facteur d’utilance (U)..................................................................................................... 37 II.6.5 Le facteur de dépréciation (d)............................................................................................. 37 II.6.6 Le flux total nécessaire (F) ................................................................................................. 38 II.6.7 Nombre minimale de luminaires (N) .................................................................................. 38 II.6.8 Uniformité et inter distances............................................................................................... 38 II.7 Eclairage de secours ..................................................................................................................... 39 II.7.1 Définition............................................................................................................................ 39 II.7.2 Fonctions de l’éclairage de sécurité.................................................................................... 40 II.7.2.1 L’éclairage d’évacuation........................................................................................... 40 II.7.2.2 L’éclairage d’ambiance ou anti-panique ................................................................... 40 II.7.3 Implantation des blocs d’éclairage de sécurité.................................................................... 40
- 7. vi II.8 Etude de l’éclairage extérieur....................................................................................................... 41 II.8.1 But de l’éclairage extérieur................................................................................................. 41 II.8.2 Les critères de qualité d’éclairage....................................................................................... 41 II.8.3 Point lumineux.................................................................................................................... 42 II.8.4 Types d’implantations......................................................................................................... 42 II.8.4.1 Implantation unilatérale (gauche ou droite)............................................................... 43 II.8.4.2 Implantation bilatérale en quinconce......................................................................... 44 II.8.4.3 Implantation bilatérale vis-à-vis................................................................................ 44 II.8.4.4 Implantation axiale (rétro-bilatérale)......................................................................... 44 II.8.5 Canalisations protection et mise à la terre .......................................................................... 46 II.8.5.1 Canalisation............................................................................................................... 46 II.8.5.2 Protection différentiel................................................................................................ 46 II.8.5.3 Mise à la terre............................................................................................................ 47 II.9 Exemple de calcul théorique intérieur.......................................................................................... 48 II.9.1 Donnés du local .................................................................................................................. 48 II.9.2 La hauteur utile hu :............................................................................................................ 49 II.9.3 L’indice du local K : ........................................................................................................... 49 II.9.4 Le rapport de suspension J.................................................................................................. 49 II.9.5 Le facteur d’utilance ........................................................................................................... 49 II.9.6 Le facteur de dépréciation................................................................................................... 49 II.9.7 Flux total nécessaire............................................................................................................ 50 II.9.8 Nombre de luminaires......................................................................................................... 50 II.9.9 Répartition sur le local........................................................................................................ 50 II.10 Outil logiciel................................................................................................................................. 51 II.10.1 Présentation du logiciel Dialux EVO............................................................................. 51 II.10.2 Comparaison des résultats obtenue ................................................................................ 51 II.11 Caractéristique techniques et normalisation................................................................................. 53 II.11.1 Marquage de classification et de contrôle...................................................................... 53 II.11.2 Niveau d’éclairement moyen ......................................................................................... 54 II.12 Conclusion.................................................................................................................................... 54 CHAPITRE III. ETUDE TECHNIQUE COURANT FORT COURANT FAIBLE ............................................. 55 III.1 Introduction.................................................................................................................................. 55 III.2 Etude théorique de l’installation BT............................................................................................. 55
- 8. vii III.2.1 La protection électrique.................................................................................................. 55 III.2.1.1 Les surcharges........................................................................................................... 56 III.2.1.2 Les court-circuit ........................................................................................................ 56 III.2.1.3 Les courants de fuites................................................................................................ 56 III.2.2 Le sectionnement ........................................................................................................... 56 III.2.3 La commande des circuits.............................................................................................. 57 III.2.3.1 Commande fonctionnelle .......................................................................................... 57 III.2.3.2 Coupure d’urgence - arrêt d’urgence......................................................................... 57 III.2.3.3 Coupure pour entretien mécanique............................................................................ 58 III.2.3.4 Appareillages électriques .......................................................................................... 58 III.2.4 Méthodologie de dimensionnement de l’installation BT ............................................... 59 III.2.4.1 Détermination des sections des câbles....................................................................... 59 III.2.4.1.1 La lettre de sélection ........................................................................................................... 59 III.2.4.1.2 Le facteur de correction K1................................................................................................. 60 III.2.4.1.3 Le facteur de correction K2................................................................................................. 60 III.2.4.1.4 Le facteur de correction K3................................................................................................. 60 III.2.4.1.5 Le courant admissible Iz ..................................................................................................... 61 III.2.4.1.6 La section minimale............................................................................................................ 61 III.2.4.2 Détermination de la chute de tension en régime permanant...................................... 62 III.2.4.2.1 Calcul de chute de tension................................................................................................... 63 III.2.4.3 Détermination des courants de courts circuits........................................................... 64 III.2.4.3.1 Définition............................................................................................................................ 64 III.2.4.3.2 Origine ................................................................................................................................ 64 III.2.4.3.3 Calcul de Icc ....................................................................................................................... 65 III.2.4.4 Détermination des calibres des disjoncteurs.............................................................. 66 III.2.4.4.1 Définition............................................................................................................................ 66 III.2.4.4.2 Critères de choix ................................................................................................................. 66 III.3 Exemple de calcul théorique ........................................................................................................ 67 III.3.1 Prérequis ........................................................................................................................ 67 III.3.2 Section du câble ............................................................................................................. 68 III.3.2.1 Lettre de sélection ..................................................................................................... 68
- 9. viii III.3.2.2 Facteur de correction K1........................................................................................... 68 III.3.2.3 Facteur de correction K2........................................................................................... 68 III.3.2.4 Facteur de correction K3........................................................................................... 68 III.3.2.5 Facteur de correction globale K ................................................................................ 68 III.3.2.6 Le courant admissible Iz............................................................................................ 69 III.3.2.7 La section minimale .................................................................................................. 69 III.3.2.8 La chute de tension.................................................................................................... 69 III.3.2.9 Le courant de court-circuit ........................................................................................ 70 III.3.3 Choix du disjoncteur ...................................................................................................... 71 III.3.4 Résultat obtenue par le logiciel Caneco BT................................................................... 72 III.4 Dimensionnement du transformateur ........................................................................................... 73 III.4.1 Calcul de puissance........................................................................................................ 73 III.4.2 Choix du transformateur ................................................................................................ 74 III.4.2.1 Données technique .................................................................................................... 74 III.4.2.1.1 Haute tension ...................................................................................................................... 74 III.4.2.1.2 Transformateur avec conservateur ...................................................................................... 75 III.4.2.1.3 Résistance mécanique de la cuve ........................................................................................ 75 III.4.2.1.4 Tenue en court-circuit ......................................................................................................... 75 III.4.2.2 Accessoires et équipement de sécurité ...................................................................... 75 III.4.2.2.1 Soupape de sécurité............................................................................................................. 75 III.4.2.2.2 Relais Buchholz .................................................................................................................. 75 III.5 Etude Pratique de l’installation BT .............................................................................................. 76 III.5.1 Outils logiciels ............................................................................................................... 76 III.5.1.1 Logiciel Revit............................................................................................................ 76 III.5.1.2 Logiciel Navisworks ................................................................................................. 77 III.5.1.3 Logiciel Elium........................................................................................................... 78 III.5.1.4 Logiciel Caneco BT .................................................................................................. 78 III.5.2 Bilans de puissances....................................................................................................... 79 III.5.3 Notes de calculs CANECO ............................................................................................ 80 III.5.4 Schémas unifilaires et armoires électriques ................................................................... 81 III.6 Maquettage du local technique..................................................................................................... 83 III.6.1 Raccordement des transformateurs ................................................................................ 83
- 10. ix III.6.1.1 Raccordement sur un réseau radial MT : simple dérivation ...................................... 83 III.6.1.2 Raccordement sur une boucle MT : coupure d’artère................................................ 83 III.6.2 Liaison des 2 transformateurs ........................................................................................ 85 III.6.3 Local transformateur bâtiment Z.................................................................................... 85 III.6.4 Local TGBT................................................................................................................... 86 III.7 Courant faible............................................................................................................................... 87 III.7.1 Introduction.................................................................................................................... 87 III.7.2 Equipements................................................................................................................... 87 III.7.2.1 Ethernet RJ45............................................................................................................ 87 III.7.2.2 Prise TV .................................................................................................................... 87 III.7.2.3 Prise Téléphonique.................................................................................................... 87 III.7.2.4 Borne WIFI ............................................................................................................... 88 III.7.3 Distribution .................................................................................................................... 88 III.8 Sécurité incendie .......................................................................................................................... 88 III.8.1 Introduction.................................................................................................................... 88 III.8.2 Organisation générale d’un système de sécurité incendie (SSI) :................................... 89 III.8.3 La détection.................................................................................................................... 89 III.8.3.1 Détecteur optique de fumée....................................................................................... 90 III.8.3.2 Détecteur linéaire de fumée....................................................................................... 90 III.8.3.3 Détecteur de flamme infrarouge ou ultraviolet.......................................................... 90 III.8.3.4 Détecteur de chaleur thermo vélocimétrique............................................................. 90 III.8.3.5 Déclencheurs manuels............................................................................................... 90 III.8.4 Traitement des alarmes incendie.................................................................................... 91 III.8.5 L’évacuation .................................................................................................................. 91 III.8.5.1 Diffuseurs Sonores (DS) ........................................................................................... 91 III.8.5.2 Diffuseur sonore avec flash (DSNAL)...................................................................... 92 III.8.6 Le compartimentage....................................................................................................... 92 III.8.7 Le désenfumage ............................................................................................................. 92 III.9 Conclusion.................................................................................................................................... 93 Conclusion générale ............................................................................................................ 94 Bibliographie ....................................................................................................................... 95
- 11. x Annexe 1 Rapport d’étude d’éclairement Salle de classe.................................................... Annexe 2 Norme d’installation électrique........................................................................... Annexe 3 Norme de dimensionnement d’un départ............................................................ Annexe 4 Rapport Caneco BT départ compresseur.............................................................
- 12. xi Liste des figures Figure 1 - Daimler Mercedes ............................................................................................................. 1 Figure 2 - Noom Palms Village.......................................................................................................... 1 Figure 3 - Lycée Secondaire............................................................................................................... 2 Figure 4 - Les Niveaux du BIM ......................................................................................................... 8 Figure 5 - Cycle de vie du bâtiment ................................................................................................... 9 Figure 6 - Cité Scolaire de Saint Georges de l'Oyapock.................................................................. 12 Figure 7 - Localisation Géographique.............................................................................................. 13 Figure 8 - Plan Masse Cité Scolaire................................................................................................. 17 Figure 9 - Composition de la Lumière ............................................................................................. 19 Figure 10 - La Vision ....................................................................................................................... 20 Figure 11 - Flux Lumineux .............................................................................................................. 20 Figure 12 - L'intensité Lumineuse.................................................................................................... 21 Figure 13 - L'intensité Lumineuse.................................................................................................... 21 Figure 14 - Les 8 Couleurs de Test IRC........................................................................................... 23 Figure 15 - Température de Couleur................................................................................................ 23 Figure 16 - Ambiance Local............................................................................................................. 24 Figure 17 - Courbe Photométrique................................................................................................... 24 Figure 18 - Diagramme Simplifié .................................................................................................... 25 Figure 19 - Eblouissement................................................................................................................ 26 Figure 20 - Efficacité Lumineuse..................................................................................................... 26 Figure 21 - Classes des Luminaires.................................................................................................. 28 Figure 22 - LED SMD...................................................................................................................... 30 Figure 23 - LED High Power........................................................................................................... 30 Figure 24 – LED COB ..................................................................................................................... 31 Figure 25 - Liaison DALI................................................................................................................. 33 Figure 26 - Système de Contrôle d'éclairage.................................................................................... 34
- 13. xii Figure 27 - Commande par ligne de Luminaires.............................................................................. 34 Figure 28 - Paramètres du local........................................................................................................ 36 Figure 29 - Facteur d'utilance........................................................................................................... 37 Figure 30 - Inter distance des luminaires ......................................................................................... 39 Figure 31 - Eclairage normal............................................................................................................ 39 Figure 32 - Eclairage de remplacement............................................................................................ 39 Figure 33 - Eclairage de sécurité...................................................................................................... 39 Figure 34 - Bloc d'évacuation .......................................................................................................... 40 Figure 35 - Bloc d'ambiance ............................................................................................................ 40 Figure 36 - Grandeurs photométriques éclairage public .................................................................. 42 Figure 37 - Point lumineux.............................................................................................................. 42 Figure 38 - Paramètres d'implantation ............................................................................................. 43 Figure 39 - Implantation unilatérale................................................................................................. 43 Figure 40 - Implantation en quinconce ............................................................................................ 44 Figure 41 - Implantation vis-à-vis.................................................................................................... 44 Figure 42 - Implantation axiale........................................................................................................ 44 Figure 43 - Eclairage extérieur......................................................................................................... 45 Figure 44 - Remonter interne en candélabre.................................................................................... 46 Figure 45 - Alimentant des luminaires de classe II – Distribution en câbles................................... 47 Figure 46 - Mise à la terre par dérivation sur le conducteur de protection (PE) .............................. 47 Figure 47 - Plan salle de classe ........................................................................................................ 48 Figure 48 - Tableau d'utilance.......................................................................................................... 49 Figure 49 - Implantation luminaires................................................................................................. 50 Figure 50 - Implantation luminaires valide...................................................................................... 51 Figure 51 - Résultats dialux ............................................................................................................. 52 Figure 52 - Photo réel dialux........................................................................................................... 53 Figure 53 - Marquage de classification............................................................................................ 53 Figure 54 - Types des conducteurs................................................................................................... 59
- 14. xiii Figure 55 - Types de court-circuit.................................................................................................... 65 Figure 56 - Courbe de déclanchement.............................................................................................. 67 Figure 57 - Extracteur ...................................................................................................................... 68 Figure 58 - Circuit de l'extracteur .................................................................................................... 70 Figure 59 - Résultats Caneco ........................................................................................................... 73 Figure 60 - Logiciel Revit................................................................................................................ 77 Figure 61 - Logiciel Navisworks...................................................................................................... 77 Figure 62 - Logiciel Elium............................................................................................................... 78 Figure 63 - Logiciel Caneco BT....................................................................................................... 79 Figure 64 - Extrait bilan de puissance.............................................................................................. 80 Figure 65 - Extrait note de calcul Caneco BT.................................................................................. 80 Figure 66 - Extrait schéma unifilaire................................................................................................ 81 Figure 67 - Schéma d'encombrement TGBT_P1 ............................................................................. 82 Figure 68 - Raccordement en antenne.............................................................................................. 83 Figure 69 - Raccordement en boucle................................................................................................ 84 Figure 70 - Local transformateur ..................................................................................................... 86 Figure 71 - Local TGBT................................................................................................................... 86 Figure 72 - Organisation générale système SSI ............................................................................... 89 Figure 73 - Niveaux de détection..................................................................................................... 89 Figure 74 - Détecteur optique de fumée........................................................................................... 90 Figure 75 - Détecteur linéaire........................................................................................................... 90 Figure 76 - Détecteur de flamme...................................................................................................... 90 Figure 77 - Détecteur thermo vélocimétrique .................................................................................. 90 Figure 78 - Déclencheur manuel...................................................................................................... 90 Figure 79 - Centrale de détection incendie....................................................................................... 91 Figure 80 - Diffuseur sonore............................................................................................................ 91 Figure 81 - Diffuseur sonore avec flash........................................................................................... 92 Figure 82 - Le Compartimentage ..................................................................................................... 92
- 15. xiv Figure 83 - Le désenfumage............................................................................................................. 93
- 16. xv Liste des tableaux Tableau 1 - Valeurs usuelles de luminance...................................................................................... 22 Tableau 2 - Perception de Couleur................................................................................................... 23 Tableau 3 - Facteur d'éblouissement................................................................................................ 25 Tableau 4 - Duré de Vie Moyenne................................................................................................... 27 Tableau 5 - Tableau de Classes de Protections IP............................................................................ 28 Tableau 6 - Indice de Protection IK ................................................................................................. 29 Tableau 7 - IP et IK selon NF C 15-100 .......................................................................................... 29 Tableau 8 - Eclairement moyen à maintenir en fonction de l'activité.............................................. 35 Tableau 9 - Facteurs de réflexion..................................................................................................... 36 Tableau 10 - Facteur de dépréciation............................................................................................... 37 Tableau 11 - Règles d'implantation éclairage de secours................................................................. 40 Tableau 12 - Types d'implantations ................................................................................................. 45 Tableau 13 - Fonctions de bases des appareils électriques............................................................... 58 Tableau 14 - Lettre de selection...................................................................................................... 59 Tableau 15 - Facteur de correction K1............................................................................................. 60 Tableau 16 - Facteur de correction K2............................................................................................. 60 Tableau 17 - Facteur de correction K3............................................................................................. 61 Tableau 18 - Abaque sections des câbles......................................................................................... 62 Tableau 19 - Chute de tension maximale......................................................................................... 62 Tableau 20 - Calcul chute de tension ............................................................................................... 63 Tableau 21 - Abaque chute de tension ............................................................................................. 64 Tableau 22 - Résistances et réactances ............................................................................................ 65 Tableau 23 - Abaque courant de court-circuit.................................................................................. 66 Tableau 24 - Les courbes de déclenchements .................................................................................. 72
- 17. xvi Liste des abréviations BT : Basse tension ESQ : Etude d’esquisse APS : Avant-projet sommaire APD : Avant-projet détaillé DAO : Dossier appel d’offre ERP : Les bâtiments recevant du public IGH : Les immeubles de grande hauteur ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement NF : Norme française IRC : Indice de rendue de couleur CCT : Température de couleur UGR : Unified Glare Rating DALI : Digital Addressable Lighting Interface CE : Communauté Européenne MT : Moyenne tension EN : European Norm, adoptée par le Comité Européen de Normalisation RJ : Registered Jack (prise jack déposée) HT : Haute tension TBT : Tableau basse tension TGBT : Tableau générale basse tension MN : Maquettes numériques BIM : Building Information Modeling
- 18. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 1 Figure 1 - Daimler Mercedes Figure 2 - Noom Palms Village Présentation de l’entreprise HK CONSULTING est un bureau d’études pluridisciplinaires réunissant 3 pôles majeurs : Ingénierie énergétique & Thermique. Ingénierie électrique. Ingénierie de la structure. HK CONSULTING propose des études englobant la totalité des réseaux organiques du bâtiment et l’étude des fluides (plomberie, électricité, climatisation, chauffage, ventilation, sanitaire…). On peut citer parmi les références significatives de HK CONSULTING les projets suivants: DAIMLER MERCEDES – France Etude réseaux HT, MT, BT. Etude d’éclairement. Elaboration des plans CFO, CFA, ECL et Maquette 3D. Réalisation des schémas unifilaires. Dimensionnement transfo et groupe électrogène. Suivie chantier et gestion de projet. NOOM PALMS VILLAGE Etude d’éclairement des zones nobles. Etude réseaux MT, BT et Fibre optique. Elaboration du CCTP et Bordereau des prix.
- 19. INTRODUCTION GENERALE 2 Figure 3 - Lycée Secondaire Lycée Secondaire Tunis, Tunisie Etude d’éclairement des différents locaux administratifs et salles de cours. Elaboration des plans CFO, CFA, ECL. Réalisation des schémas unifilaires. Réalisation NDC et schémas unifilaires des différentes armoires. Suivi Chantier. Les équipes de HK CONSULTING sont composées de professionnels dotés d’une grande expérience dans divers domaines, d’un savoir-faire et d’un fort esprit d’équipe. Chaque projet qui leur est confié est minutieusement diagnostiqué afin de garantir le succès de son aboutissement dans les plus brefs délais. Ainsi ce bureau d’étude spécialisé dans le bâtiment et le développement urbain à une expérience reconnue dans les activités ci-dessous : Ingénierie du Bâtiment. Modélisation BIM. Maitrise d'œuvre. Pilotage, Suivi & Direction des Travaux. Assistance à la mise en service. Formation.
- 20. INTRODUCTION GENERALE 3 Introduction générale La transition énergétique est aujourd’hui au centre des préoccupations et avec elle, on parle aussi de maîtrise de la facture et de baisse de consommation. Quoiqu’il en soit, s’il y a bien un acteur indissociable de ce processus, c’est le bureau d’études en électricité. La part de l’électricité dans la facture énergétique peut varier d’une structure à l’autre mais en général, il est toujours possible de réaliser des économies grâce à l’amélioration de la performance énergétique. Le syndicat de l’énergie affirme même que ces économies peuvent atteindre les 80% avec la rationalisation du réseau et la limitation du gaspillage. Dans ce but, l’étude d’une installation électrique implique que l’on ait rassemblé toutes les informations permettant de déterminer avec certitude les circuits et les caractéristiques physiques et dimensionnelles des matériels. L’objectif est résumé par deux critères : L’obligation des résultats relativement aux performances recherchées et aux normalisations internationales en respectant les règles de sécurité. Garantir la rentabilité économique de l’installation. En parallèle, le BIM (Building Information Modeling), représente un outil collaboratif puissant d’amélioration de la gestion de projet et de productivité : gain en temps et en qualité, détection précoce des erreurs et des conflits, partage des données et travail collaboratif tout au long du cycle de vie du bâtiment, depuis la phase consistant à le concevoir, à le construire, à l’exploiter et à le maintenir jusqu’à celle de le déconstruire. Cet outil technologique participe fortement à l’atteinte des objectifs énergétiques et environnementaux, de manière durable, tout en respectant les politiques d’environnement. Il contribue à la création du bâtiment de demain, un bâtiment intelligent capable de gérer ses flux, d’économiser l’énergie, d’être un lieu de vie, de confort et de santé pour ses occupants. Il est important aujourd’hui de développer et de diffuser rapidement les technologies à chaque phase de la construction et de l’exploitation. Il est également indispensable de veiller à l’évolution dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation.
- 21. INTRODUCTION GENERALE 4 Dans ce contexte, et dans le cadre de ma formation en génie électrique et informatique industriel à l’Université Libre de Tunis, j’ai eu l’opportunité de réaliser mon projet de fin d’étude au sein du bureau d’étude HK-Consulting sur un projet de cité scolaire situé en Île de France. Le rapport que nous présentons est une brève présentation des tâches effectuées durant ce projet. Il est structuré en trois chapitres : Dans le premier chapitre nous allons présenter les bureaux d’études, le concept du BIM et le cadre du projet à réaliser en étudiant sa problématique. Le deuxième s’intéresse à la partie éclairage des bâtiments, en comparant les résultats du calcul à la main avec celles obtenue par les logiciels de conception (Dialux). Le troisième chapitre synthétise la partie dimensionnement des départs de l’installation électrique, des bilans de puissances, et des notes calculs élaboré par les calculs manuels et par le logiciel CANECO, ensuite nous exposant les normes et les équipements qui concerne les lots courant faible et sécurité incendie.
- 22. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 5 Chapitre I. Introduction et cadre du projet I.1 Introduction Nous commençons ce premier chapitre par la présentation de l’environnement du travail à travers quelques généralités sur le bureau d’étude ainsi que le concept du BIM (Building Information Modeling) ces avantages, ces outils, ces dimensions et ces niveaux et en fin le développement du projet, de son cadre et du travail qu’on nous demande de réaliser tout au long la durée du stage. I.2 Généralité sur les bureaux d’études Un bureau d'études peut désigner soit un cabinet indépendant, soit un département ou un service au sein d'une administration ou d'une entreprise. Il s'agit d'une structure où sont réalisées des expertises à caractère scientifique et/ou technique, généralement sous la responsabilité d'un ingénieur. Ces expertises peuvent recouvrir entre autres les champs de l'analyse de l'existant (état des lieux) ou bien la conception d'un produit ou l'organisation d'un service. Les bureaux d'études ont un rôle d'assistance et de conseil auprès des collectivités publiques ou des entreprises. Les compétences des bureaux d'études peuvent être en relation avec des domaines extrêmement variés tels que : le Génie civil, l’électricité, énergétique, Thermique etc. L'activité des bureaux d'études relève du domaine des services : les prestations sont de caractère intellectuel. Un bureau d'études ne réalise pas directement de travaux ou de fourniture, mais ils interviennent en général en amont afin d'effectuer des recommandations préalables, ou en aval pour vérifier la qualité des réalisations.
- 23. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 6 I.3 Le besoin A l’origine du projet, la maîtrise d’ouvrage (qui peut être une personne physique, morale, un particulier ou une entreprise) possède un besoin bien spécifique (création d’une usine, d’une habitation personnelle, etc…). Néanmoins, elle ne possède pas les compétences techniques pour réaliser son ouvrage. Généralement, on fait alors appel à une maîtrise d’œuvre (souvent un cabinet d’architecte pour les projets complexes) pour pallier ces problèmes. Le cabinet d’architecte s’associe à un ou plusieurs bureaux d’ingénierie (ou bureaux d’études techniques) pour l’étude et l’élaboration des plans (structure, sanitaire, chauffage, électricité, etc…). Différentes séances sont établies entre le client et le(s) bureau(x) d’ingénieurs/architectes pour préciser les besoins et instaurer un cahier des charges bien défini. La maîtrise d’œuvre conçoit ainsi le projet. I.4 Les phases d’un projet Chaque projet doit généralement passer par plusieurs phases pour qu’il soit finalement livré. I.4.1 Etude d’esquisse - ESQ Dans cette phase, l’architecte est demandé de présenter les résultats de sa première étude de faisabilité du bâtiment souhaité en tenant compte des options de construction envisagées par le maître d’ouvrage et en fonction des différents paramètres liés au terrain. Si le maitre d’ouvrage est satisfait des premières missions d’étude de faisabilité et de réalisation d’esquisse, il peut décider de poursuivre les travaux dans les études d’avant- projet. I.4.2 Avant-projet sommaire – APS A ce point on doit fournir une description précise des différentes options retenues pour le projet, et une estimation du coût et de la durée des travaux. Une certaine tolérance peur être ménager en fonction de la taille du projet et de l’état d’avancement des travaux d’études.
- 24. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 7 I.4.3 Avant-projet détaillée – APD A cette étape nous allons vérifier les dernières mises au point effectuées en fonction des options retenues par le maitre d’ouvrage, le choix des matériaux selon les différentes prestations techniques et en conformité avec les réglementations, une étude d’approvisionnement et un bilan thermique doivent être engagés. Un chiffrage précis de l’ensemble du projet est alors finalisé. Les documents qui détaillent les caractéristiques définitives du projet et des performances convenues sont rédiger de manière formelle à fin d’obtenir le permis de construction. I.4.4 Dossier d’appel d’offres – DAO Cette phase est principalement consacrée à l’élaboration des pièces écrites du Dossier d’Appel d’offres. Durant cette période le bureau d’étude d’électricité doit élaborer les plans détaillés courant fort, faible, études d’éclairements, bilan de puissance et schémas unifilaires des armoires électriques. Ce dossier va être utiliser pour consulter les entreprise d’exécution afin qu’ils fournissent des offres techniques et financières. I.4.5 Dossier d’exécution Les études d’exécution ont pour objet la réalisation technique du bâtiment, ces plans sont généralement élaborer par l’entreprise d’exécution, soit par ses ingénieurs ou par l’intermédiaire d’un bureau d’étude, ce dossier doit contenir l’état de l’installation (cheminements, implantations) conforme à leurs exécutions en chantier. I.5 BIM (Building Information Modeling) I.5.1 Contexte Tout le monde connait probablement des logiciels qui permettent de dessiner très rapidement en 3D. Ils sont généralement parfaits pour illustrer ce que n’est PAS le BIM : les objets dessinés ne sont que des volumes, sans aucune forme d’intelligence. Une maquette 3D ne
- 25. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 8 peut rentrer dans le cadre d’un processus BIM qu’à la condition d’être porteuse d’une base de données associée à chaque objet. Nous attirons donc votre attention sur ce détail de langage important, mais qui provoque de nombreuses erreurs et incompréhensions au sujet du BIM : « BIM » et « maquette numérique » ne sont pas des synonymes. La maquette numérique, à la condition qu’elle soit « sémantisée », c’est-à-dire porteuse d’intelligence, est un outil au service du processus BIM. I.5.2 La modélisation Un autre point à bien comprendre tient à la nature même de ce qui compose cette maquette numérique. Sur un plan DWG (AutoCAD) classique, la représentation du bâtiment est obtenue grâce à des formes géométriques (traits, polygones, courbes, points, textes). Même si certaines aides au dessin (accrochage aux extrémités des segments, contraintes dimensionnelles entre formes géométriques) peuvent être assimilés à une forme d’intelligence, celles-ci ne suffisent pas à conférer à ces dessins vectoriels les caractéristiques suffisantes pour être qualifiées de maquette BIM. Dans une maquette numérique BIM, on ne dessine pas des formes géométriques, mais des objets. Pour tracer un mur, on utilise le bouton « Mur », pour tracer un plancher, la fonction « Plancher ». Figure 4 - Les Niveaux du BIM
- 26. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 9 Alors, que la majorité des chantiers sont actuellement réalisés au « Niveau 0 », certains le sont au « Niveau 1 », mais cela ne concerne jamais tous les intervenants du projet et l’emploi de la 3D ne relève actuellement que de « l’anecdote ponctuelle ». I.5.3 Le BIM à travers le cycle de vie d’un bâtiment I.5.3.1 Du programme à la déconstruction Le BIM est présent dans toutes les phases d’un projet de bâtiment, de l’élaboration du programme jusqu’à sa déconstruction. Sur le schéma ci-dessous, vous pouvez voir les différentes étapes du cycle de vie d'un ouvrage. Avec l'idée de regrouper et de partager les informations, il permet de maintenir une continuité à travers toute la vie de l’ouvrage. L’autre intérêt du BIM est de pouvoir anticiper les erreurs, que ce soit à travers l’analyse des collisions entre deux maquettes ou avec une meilleure coordination des équipes en exécution grâce aux maquettes. Et, même si les différents intervenants ne sont pas intéressés par le BIM de la même manière, chacun y trouve tout de même son intérêt. Figure 5 - Cycle de vie du bâtiment
- 27. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 10 Au cours d'un projet, il n’y a pas une maquette numérique unique, mais plusieurs. En phase de conception, par exemple, les architectes, les bureaux d’études et les autres intervenants génèrent chacun leur propre maquette numérique de conception. Cela permet d'atteindre les objectifs du bâtiment selon la solution métier de chacun, de simuler et d'analyser la faisabilité de l'édifice. Ces maquettes seront ensuite concaténées par le BIM Manager. Au-delà de l’aspect graphique, les données, qui je le rappelle sont la base du BIM, sont différentes suivant les contributeurs. Les maquettes permettront d'en analyser les différents aspects. Voici quelques exemples d’informations issues des maquettes numériques (MN) et les fins auxquelles elles sont utilisées : La MN Architecture La MN Structure La MN MEP La MN de coordination I.5.4 La Charte BIM : stratégie générale de la maîtrise d’ouvrage La Charte BIM est la définition de la stratégie globale de la maîtrise d’ouvrage vis-à-vis du BIM. Elle définit ses attentes, en termes de modélisation ou de livrables, par exemple. Elle explique également les objectifs généraux et la vision du BIM. La charte peut également préciser les outils numériques qui seront utilisés et son organisation interne. Pour les plus avancés, la Charte BIM pourra définir si des outils numériques de gestion de patrimoine seront utilisés ainsi que la codification et la classification à respecter. Ces éléments structureront les maquettes numériques des différents contributeurs suivant les phases du projet. I.5.5 Le Cahier des Charges BIM : besoins spécifiques de la maîtrise d’ouvrage sur un projet particulier Le cahier des charges est le pendant de la Charte BIM, mais pour un projet spécifique. En général, nous retrouvons la structuration de la charte, mais chaque partie est interprétée pour le projet.
- 28. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 11 Les éléments principaux précisés sont les acteurs et les missions des Contributeurs BIM, les échanges et les contrôles BIM attendus ainsi que les Objectifs BIM du projet. I.5.6 La Convention BIM : document fédérateur de la maîtrise d’œuvre du projet La Convention BIM est le document réalisé par le BIM Management, en coopération avec les différents contributeurs de la maîtrise d’œuvre. Ce document est nécessaire dans la mesure où les thèmes couverts par celui-ci ne sont actuellement pas décrits par les documents contractuels. Les effets juridiques et l’adhésion à la démarche sont inhérents à la Convention BIM, car elle engage d’un commun accord ceux qui la reconnaissent. La Convention BIM est une réponse au Cahier des Charges BIM, selon le schéma que nous avons vu précédemment. Elle doit être approuvée par toutes les parties contribuant au projet, quelle que soit la nature de leur contribution à la Maquette Numérique. La Convention BIM suit un ordre logique d’enchaînement des tâches. I.5.7 Conclusion Le BIM intervient sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. À chaque phase, les maquettes sont différentes, tant par leurs qualités graphiques que par les données qu’elles intègrent. Cela est notamment dû au fait que les différents contributeurs ont des attentes métiers différentes. Toutefois, à un moment, ces maquettes sont réunies. On dit qu’elles sont concaténées. Le but est de vérifier la cohérence du travail de chacun dans un ensemble qui ressemblera au futur bâtiment.
- 29. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 12 I.6 Cadre du projet I.6.1 Contexte La collectivité territoriale de Guyane est promotrice de la construction de deux nouveaux pôles scolaires : le Complexe scolaire de Saint-Georges de l’Oyapock et le Lycée de Macouria. La mission de MBAcity pour chacun de ces deux projets est de réaliser une mission de Présynthèse Tous les Corps d’État (TCE) et BIM Management pendant toute la phase de conception et une mission de Synthèse TCE et BIM Management pendant la phase d’exécution. I.6.2 Cité scolaire de Saint Georges de l’Oyapock – Fiche Projet Il s’agit d’un groupe scolaire d’enseignement du secondaire, situé à Saint-Georges de l’Oyapock. Sur une parcelle de 8 hectares, il comptabilise une surface utile de 19 767 m² et une surface extérieure de 16 072 m². Ce complexe est composé d’un collège de 600 places, d’un lycée de 765 élèves qui comprendra quatre filières (ÉNERGIE, GESTION, ESS social, BOIS), un internat de 140 places, un pôle dédié à la restauration et des équipements sportifs. Figure 6 - Cité Scolaire de Saint Georges de l'Oyapock
- 30. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 13 Figure 7 - Localisation Géographique Maitrise d'ouvrage : Collectivité territoriale de Guyane Client : Collectivité territoriale de Guyane Architecte : Peerdeo Singh, Yves Le Tirant, BMC Architecte Lieu : Saint-Georges de L'Oyapock, Guyane (973) Surface : 19 800 m² Dates : Depuis 2018 Montant des travaux : 67 M€ La cité scolaire sera décomposée comme suit : I.6.2.1 1er groupement de bâtiments Bat. A1 – Cuisine/Restauration Bat. A2 –Salle polyvalente Bat. B – Atelier Energie Bat. D – Economie et Social Bat. G – Administration / Vie scolaire Bat. I – Foyer Collégiens Bat. L– Enseignement Général (L1A/L1B) et Loge gardien Bat. M – Hall Sportif
- 31. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 14 Espaces extérieurs Plateau sportifs extérieurs I.6.2.2 2eme groupement de bâtiments Bat. C – Commun Energie et Accompagnement Bat. E – Gestion et Commun Bois Bat. F – Atelier Bois Bat. H – Foyer Lycéens Bat. J - SEGPA Bat. K – Pôle logistique Bat. L– Enseignement Général (L2A/L2B) Bat. N/O/P/Q - carbet Bat. R – Dortoir filles Bat. S – Pôle carbet internat Bat. T – Dortoir garçons I.6.2.3 Depuis un poste EDF en limite de propriété : Bat. U/V/W/X – Logements de fonction enseignement, Bat. L – Logement gardien. Bat. Z/Y – Locaux techniques. I.6.2.4 Classification des bâtiments I.6.2.4.1 Définitions de bases Les établissements sont classés en 5 grande familles : ERP : Les bâtiments recevant du public. IGH : Les immeubles de grande hauteur ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement. Habitation : Les bâtiments à usage d'habitation. Les Dispositions transitoires. Notre projet rentre dans la famille ERP.
- 32. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 15 I.6.2.4.2 Les bâtiments recevant du public (ERP) Sont considérés comme bâtiments recevant du public, toutes les constructions et tous les locaux et espaces qui reçoivent des personnes ou dans lesquels se tiennent des réunions privées ou ouvertes au public, à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes présentes dans le bâtiment à quelque titre que ce soit. I.6.2.4.3 Les catégories des ERP Les bâtiments recevant du public sont classés dans des types, selon la nature de l'activité qui y est exploitée, ces bâtiments recevant du public, quel qu'en soit le type, sont classés dans cinq catégories, selon leur capacité d'accueil du public, comme suit : Première catégorie : plus de 1500 personnes. Deuxième catégorie : de 701 personnes à 1500 personnes. Troisième catégorie : de 301 personnes à 700 personnes. Quatrième catégorie : de 51 personnes à 300 personnes. Cinquième catégorie : les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas les cinquante personnes. La capacité d'accueil du bâtiment recevant du public est fixée, selon les cas, conformément à l'un ou à l'ensemble des critères suivants : Le nombre de places assises. Le nombre de lits. La superficie réservée au public. La déclaration du propriétaire du bâtiment, vérifiée par les services de la protection civile. I.6.2.4.4 Les types des ERP Type J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Type L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Type M : Magasins de vente, centres commerciaux Type N : Restaurants et débits de boisson
- 33. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 16 Type O : Hôtels et pensions de famille Type P : Salles de danse et salles de jeux Type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacance, centres de loisir sans hébergement Type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives Type T : Salles d’exposition Type U : Etablissements de soins Type V : Etablissements du culte Type W : Administrations, banques, bureaux Type X : Etablissements sportifs couverts Type Y : Musées. I.6.2.4.5 Cité scolaire La déclaration du propriétaire du bâtiment, vérifiée par les services de la protection civile. Conformément à l’article GN3 du Règlement de Sécurité Incendie, la cité scolaire est un ERP (établissement recevant des publique) recevant plus de 1500 personnes, les bâtiments sont considérés comme étant isolés entre eux, de type mixte regroupant plusieurs activités et classés comme suit : Bât. L : type R, 2ème catégorie. Bât. A1 : type N, 2ème catégorie. Bât. A2 : type L, 3ème catégorie. Bât. M : type X, 4ème catégorie. Bât. R, T : type R, 4ème catégorie avec locaux à sommeil. Bât. D, E, F, G, J, K, S : type R, 5ème catégorie. Les bâtiments B et C sont soumis au code du travail. Les habitations sont en 1ère famille.
- 34. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 17 I.6.3 Plan masse La figure ci-dessous représente le plan masse de la cité scolaire : Figure 8 - Plan Masse Cité Scolaire
- 35. CHAPITRE I INTRODUCTION ET CADRE DU PROJET 18 I.6.4 Travail demandé Le bureau d’étude HK Consulting est chargé de faire l’étude de la partie électrique (courants forts et courants faibles), la partie sécurité incendie du projet décrit ci-dessus. Les taches qui m’ont étais confiée sont : Réalisation des calculs d’éclairements. Réalisation des plans d’implantations des équipements courant forts. Réalisation des plans d’implantations des équipements courant faible, sécurité incendie. Réalisation des bilans de puissances et notes de calculs de l’installation BT. Elaborations des plans de cheminements et réservations. Elaboration des schémas unifilaires et des schémas d’encombrement des armoires électrique. I.7 Conclusion Dans ce chapitre nous avons présenté l’entreprise d’accueil du stage, le projet qui nous a été confié, son cadre et sa problématique. Dans le chapitre suivant, nous allons nous intéresser à la deuxième partie qui consiste à faire l’étude de l’éclairage des bâtiments en questions.
- 36. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 19 Figure 9 - Composition de la Lumière Chapitre II. Etude d’éclairement II.1 Introduction Quel que soit le type de bâtiment, l'objectif recherché lors de la conception de l'éclairage artificiel est d’assurer le confort visuel des occupants tout en minimisant la consommation électrique qui lui est liée. Un éclairage adéquat et approprié doit être assuré en tenant compte des particularités, de l’impact des normes d'éclairement à appliquer, le choix du matériel et les solutions techniques et pratiques à mettre en place. II.2 Notions de bases II.2.1 Composition de la lumière La lumière est une énergie radiante perçue visuellement par l’œil. Elle provient de sources naturelles (soleil, étoiles) ou artificielles (ampoule) ou d’un objet réfléchissant la lumière comme la lune quand elle est éclairée par le soleil. La lumière est composée de plusieurs couleurs allant du rouge au violet qui correspondent à différentes longueurs d’onde (Figure 9). L’ensemble de ces longueurs d’onde constituant la lumière est appelé spectre, il est compris entre 380 et 780 nanomètre (1 nm = 10– 9 m). II.2.2 La vision La vision est, tout naturellement, basée sur la façon dont notre système cérébral oculaire voit des objets. L'œil soit parfois comparé à un appareil photo parce que les deux ont un objectif et un récepteur sensible à la lumière.
- 37. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 20 Figure 10 - La Vision L’observateur ne voit pas la lumière, il voit seulement les objets lorsqu’ils sont capables de renvoyer cette lumière dans son œil, donc pour être visible un objet doit pouvoir envoyer de la lumière dans l’œil de l’observateur. Pour cela, l’objet peut être soit lumineux (il émet de la lumière), soit éclairé (il renvoie de la lumière). II.3 Les grandeurs photométriques Les grandeurs photométriques sont à la base de toutes les mesures en éclairage et il faut les comprendre afin de comprendre les éventuelles documentation et fiches techniques, ce sont aussi les critères à prendre en considération pour le choix des luminaires. II.3.1 Le flux lumineux en lumens (Lm) C'est probablement l'unité d'éclairage la plus simple à comprendre, c'est l'un des premiers facteurs à prendre en compte en choisissant une source lumineuse. Il décrit l’énergie totale qu’une source lumineuse émet à travers toutes les langueurs d’ondes visibles de la lumière et dans toutes les directions, c’est-à-dire toutes les couleurs de l’arc en ciel est connu comme flux lumineux et se mesure en lumens. Puisque la visibilité n’a pas de signification que pour un spectateur humain, la lumière prend également en considération la sensibilité variable de l’œil aux différents couleurs (longueurs d’ondes). Les valeurs d’éclairement rencontrées à l’extérieur peuvent varier de 0,25 Lux dans une nuit claire à 100.000 Lux dans une journée bien ensoleiller. II.3.2 L’intensité lumineuse en candela (Cd) Une source lumineuse crée des faisceaux de lumières dont l’intensité lumineuse n’est pas forcément uniforme dans toutes les directions, elle diminue en allant du centre du luminaire Figure 11 - Flux Lumineux
- 38. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 21 Figure 12 - L'intensité Lumineuse jusqu’ à ces bords et tombe à zéro à un moment donné, donc, plus le flux lumineux des faisceaux et important, plus l’intensité mesurer en candela est importante. La candela décrit alors l’intensité lumineuse d’une source dans une direction spécifique ou le nombre de lumen par angle (lumen/angle). II.3.3 L’éclairement en Lux (Lx) Le Lux est l’un des termes les plus connus et les plus mal utilisés l’lorsqu’il s’agit d’une étude d’éclairement, il ne décrit que la quantité de lumière arrivant sur une surface, c’est la mesure du niveau d’éclairage dont le mot technique est niveau d’éclairement. Pratiquement le lux correspond à l’éclairement d’une surface de 1 mètre carrée par un flux de 1 lumen (1lux=1lumen/mètre carré). Puisque l’éclairement décrit la quantité de lumière reçue par la surface, ça ne nous dit rien sur la luminosité de cette surface car cette dernière dépend de la quantité de lumière réfléchie de la surface vers nos yeux ainsi que d’autres facteurs. Instrument de mesure : luxmètre. II.3.4 La luminance en candela/m² (Cd/m²) La luminance est souvent appelée « luminosité objective » d’une surface car elle peut être mesuré et spécifié, alors que la luminosité est une impression subjective qui varie en fonction de divers facteurs. La luminance est la seule grandeur réellement perçue par l’œil humain. Elle représente le rapport entre l’intensité de la source dans une Figure 13 - L'intensité Lumineuse
- 39. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 22 Tableau 1 - Valeurs usuelles de luminance direction donnée et la surface apparente de cette source. Elle s’exprime en candelas par mètre carré (cd/m2). L’œil humain perçoit des valeurs de luminance allant de 0,001 à 100 000 cd/m2, Le tableau suivant donne la luminance de quelques sources lumineuses : Comme cette grandeur est la seule perceptible par l’homme elle est très utilisée pour mesurer l’éblouissement (UGR), mais vu qu’elle est très difficile à quantifier ou calculer, les normalisations internationales ont fixer des niveaux d’éclairement en lux qui garantissent l’obtention des niveaux de luminances souhaiter. II.4 Caractéristiques lumineuse et électriques des luminaires II.4.1 Indice de rendue de couleur (IRC) IRC (ou Color Rendering Index CRI en anglais) est un indice qui mesure la tendance d'une source lumineuse à bien rendre les couleurs. L'étude du rendu des couleurs a été initiée par la Commission internationale de l'éclairage (CIE) en 1948. La méthode de calcul est basée sur la comparaison de l'éclairement entre la source lumineuse étudiée et la source lumineuse utilisée comme référence. La valeur moyenne de la différence évalue la distorsion colorimétrique: c'est l'indice de rendu des couleurs (IRC). 8 couleurs tests ont été définies correspondent à des couleurs de saturation modérée et de clarté moyenne semblable.
- 40. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 23 Figure 14 - Les 8 Couleurs de Test IRC Figure 15 - Température de Couleur Pour chaque couleur-test, un indice spécifique de rendu de couleur peut être calculé. L’indice général de rendu des couleurs Ra quant à lui est la moyenne arithmétique des indices particuliers pour les 8 premières couleurs-tests. Les 6+1 autres couleurs-tests peuvent être utilisées pour des indices spéciaux. Voici un aperçu de ces couleurs : L’indice de rendu des couleurs IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant l’IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur et 0 étant l’absence de couleur reconnaissable. Une différence de 5 points sera perceptible pour l’œil humaine. Tableau 2 - Perception de Couleur II.4.2 Température de couleur (CCT) en degrés Kelvin (K) La couleur de la lumière artificielle a une action directe sur la sensation de confort de l’ambiance lumineuse d’un espace. Elle n’influence cependant pas les performances visuelles. La lumière émise par une source lumineuse peut sembler Froide ou Chaude est connu comme l'apparence ou température de couleur CCT. C'est souvent indiqué dans la documentation Plage IRC Perception des couleurs Ra < 25 Faible 25 < Ra < 65 Moyenne 65 < Ra < 90 Bonne 90 < Ra Elevée
- 41. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 24 Figure 16 - Ambiance Local commerciale et les fiches techniques des luminaires comme degrés Kelvin (K). Une lumière de couleur “chaude” est composée majoritairement de radiations rouges et oranges. C’est le cas des lampes à incandescence normales, alors que plus la température de couleur est élevée, plus l'apparence de la lumière est froide (bleue) comme montrer dans le spectre. (Figure 15). Ci-dessous, on illustre la variation de la sensation de confort de l’ambiance lumineuse d’un local en fonction de la température de couleur et pour un même niveau d’éclairement. II.4.3 Courbe photométrique La courbe photométrique est un élément essentiel de l’éclairage et des caractéristiques du luminaire, elle décrit la manière dans le flux lumineux de la lampe qu’il contient est émis dans les différentes directions de l’espace. Pour caractériser un luminaire d’un point de vue photométrique, celui-ci est considéré à l’infini et il s’agit d’évaluer l’intensité du flux lumineux dans chaque direction (candela) de l’espace en trois dimensions. Cette courbe donne la répartition des intensités lumineuses (en candélas par 1000lm) dans les 2 plans de symétrie de l'appareil (figure 17), ceci permet de calculer le niveau d'éclairement en un point P sur un plan horizontal, pour les situations qui ne nécessitent pas une très grande précision, on peut utiliser le diagramme simplifié suivant (figure 18) : Figure 17 – Courbe Photométrique
- 42. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 25 Angle d’ouverture du faisceau : 32°. A 2 m de distance de la source on a : - Un éclairement au centre de la plage : 242 lux. - Un éclairement à l’extrémité du cercle 121 lux. - Diamètre du cercle éclairé : 1,20m II.4.4 Notion d’éblouissement Constructeurs et utilisateurs sont de plus en plus sensibles aux notions de confort. Ils ont ainsi développé des méthodes de calculs basées plus sur les luminaires que sur l’éclairement qui permettent d’évaluer la qualité des installations en terme de visibilité et d’éblouissement. Par l’éclairage intérieur, on utilise l’UGR (Unified Glare Rating ou méthode simplifiée d’évaluation de l’éblouissement) qui est défini par une échelle allant de 10 (aucun éblouissement) à 30 (éblouissement intolérable). Tableau 3 - Facteur d'éblouissement UGR Type d’activité < 16 Travail de précision, salle de soin 16<…<19 Bureau classique 19<…<22 Salle de repos, cantine 22<…<25 Vestiaire, salle de bain, local technique, magasin 25<…<28 Zone de circulation et couloirs >28 Dangereux, non utilisable Figure 18 - Diagramme Simplifié
- 43. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 26 Concrètement, l’éblouissement est une notion complexe à modéliser et à mesurer et n’a de sens que dans une situation spécifique, c’est-à-dire pour un observateur donné dans une pièce donnée avec des luminaires précis installés (figure 19), chaque luminaire est caractérisé par un indice d’UGR, le tableau ci-dessous contient quelques valeurs préconisées par la norme d’éclairage intérieur NF EN 12 464-2. II.4.5 Efficacité lumineuse en (lm/w) L’efficacité lumineuse d’une source est le rapport entre le flux lumineux fourni et la puissance électrique consommée pour produire cette lumière, elle s’exprime en Lumen / Watts (lm/W). Plus ce chiffre est grand, plus la lampe émet de lumière pour une même consommation électrique, ce qui signifie donc qu’on éclaire en dépensant moins et en polluant moins. II.4.6 Duré de vie moyenne La durée de vie est un autre élément essentiel à prendre en compte l’ors de choix des luminaires le tableau 4 ci-dessous est un comparatif entre les différentes technologies. Figure 19 - Eblouissement Figure 20 - Efficacité Lumineuse
- 44. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 27 Tableau 4 - Duré de Vie Moyenne Technologie IRC Efficacité lumineuse Duré de vie moyenne Lampe incandescence 90 3 – 19 lm/W 1 000 h – 1 200 h Lampe iodure métallique 95 37 – 80 lm/W 2 000 h – 3 000 h Lampe fluorescente 95 50 – 115 lm/W 6 000 h – 15 000 h Sodium haute pression 80 25 – 80 lm/W 10 000 h – 30 000 h Sodium basse pression <20 100 – 200 lm/W 16 000 h – 35 000 h Lampe à LED 90 60 – 180 lm/W 50 000 h – 100 000 h II.4.7 Classe des luminaires La différenciation des équipements électriques en « classe » vous permet de savoir de quelle manière vous êtes protégé en cas de choc électrique. Car vous devez être protégé non seulement lors d’une utilisation normale mais aussi en cas de défaillance du matériel. Il existe 4 classes, la classe 0 ne possède aucune protection et son utilisation est interdite aujourd’hui. Classe I : a un câble de mise à la terre. Toutes les parties métalliques pouvant être touchées de l’extérieur doivent être munies d’un conducteur de protection vers l’extérieur. Celui-ci décharge en toute sécurité le courant résiduel. Classe II : a une double isolation de protection. Cette double isolation se trouve souvent dans les câbles avec la fiche Euro. Classe III : désigne les appareils qui fonctionnent avec une basse tension de protection, c’est-à-dire avec des piles, des accumulateurs ou de l’énergie solaire. Cette tension est inférieure à 50 volts. Dans cette classe, aucun conducteur de protection ne peut être installé.
- 45. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 28 II.4.8 L’indice de protection IP L’indice de protection IP désigne les degrés de protection procurés par une enveloppe de matériel électrique contre : La pénétration des corps solides étrangers. L’accès aux parties dangereuses. La pénétration de poussières. La pénétration de liquides. L’indice IP est suivi par un premier chiffre qui caractérise la protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers. Un deuxième chiffre complète l’indice et correspond à la protection du matériel contre la pénétration des liquides comme indiqué par le tableau suivant : Figure 21 - Classes des Luminaires Tableau 5 - Tableau de Classes de Protections IP
- 46. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 29 Tableau 7 - IP et IK selon NF C 15-100 II.4.9 L’indice de protection IK L’indice IK correspond au degré de protection contre les impacts mécaniques externes. Il est suivi de deux chiffres qui renseignent les caractéristiques suivantes : La norme NF C 15-100 classe les locaux, attribuant à chacun un degré IP et IK adapté pour assurer la protection des matériels électriques. Voici une liste non exhaustive des pièces du logement et des indices à choisir : Tableau 6 - Indice de Protection IK
- 47. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 30 Figure 23 - LED High Power II.5 Eclairage LED II.5.1 Définition Contrairement aux autres sources lumineuses, les LED sont essentiellement des composants électroniques dont la fonction principale est d'émettre de la lumière, cette technologie est apparue pour la première fois en 1962. II.5.2 Types des LED Les puces LED sont disponibles en différentes versions de base. Les LED individuelles haute puissance sont normalement supérieures à 1 W, ceux-ci sont connus sous le nom de dispositifs de montage en surface, SMD. II.5.2.1 La LED SMD (Surface Mounting Device). Les LED SMD offraient le meilleur rendement du marché jusqu'à l'apparition des LED COB (voir ci-dessous). Elles parviennent à dépasser allègrement les 80 lumens/watt par LED contre seulement 30 ou 50 lumens maxi pour une LED DIP. Le tout pour une consommation équivalente ! Elle permet aussi d’obtenir un angle d’éclairage jusqu'à 140°, ce qui la rend ultra polyvalente dans son utilisation. II.5.2.2 La LED High-Power Les LED HIGH-POWER sont constituées d’une base de LED SMD poussées au maximum de leurs capacités sur laquelle on ajoute une lentille qui concentre la puissance lumineuse de la source, cela permet d’obtenir un rendement supérieur à la LED SMD, donc une intensité lumineuse (en lumens) supérieure elle aussi. Un des principaux inconvénients de cette LED est que l’angle d’éclairage est considérablement réduit. En moyenne 45° le deuxième inconvénient reste son prix, légèrement plus élevé qu’une ampoule LED SMD. Figure 22 - LED SMD
- 48. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 31 II.5.2.3 La LED COB Il s’agit là d’un simple assemblage de plusieurs chips lumineux (type LED SMD) disposés côte à côte pour former une grosse LED. Les avantages sont multiples et en font à ce jour la LED la plus performante du marché ! Stabilité, fiabilité, longévité, rendement, la LED COB est le haut de gamme de la LED. Une LED COB produit facilement un peu plus de 180 lumens/watt. Elle résiste aux variations de tension et possède un angle intermédiaire de 80° qui en fait la LED idéale pour un usage domestique ou extérieur. Elle produit par contre un peu plus de chaleur qu'une LED SMD, mais pas autant qu'une LED High- Power. II.5.3 Avantages II.5.3.1 Consommation électrique faible Le premier avantage et non des moindres de l’éclairage LED est sa faible consommation électrique. Il est beaucoup moins énergivore que toutes les autres technologies présentes actuellement sur le marché. Grâce à son meilleur rendement et la diminution du nombre de points lumineux, l’éclairage LED permet de réduire la facture d'électricité. II.5.3.2 Coût de maintenance réduit Les ampoules LED ont une durée de vie bien plus importante (environ 50 000 heures de fonctionnement) que les ampoules classiques (entre 1 000 et 15 000 heures). De fait, les coûts de maintenance sont quasiment inexistants. II.5.3.3 Temps de réchauffement Grâce à leur efficacité/puissance lumineuse et leur couleur naturelle très proche de la lumière du jour, les ampoules LED offrent une qualité d’éclairage excellente. Ce qui est particulièrement appréciable dans les bâtiments tertiaires/industriels, permettant d’améliorer le confort des usagers et leur productivité. Figure 24 – LED COB
- 49. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 32 De plus, contrairement aux lampes classiques, il n’y a ni scintillement, ni bruit de fond. Et pour ceux qui souhaitent créer différentes ambiances lumineuses, il est aussi possible de choisir la température de couleur (bleu, vert, jaune…). II.5.3.4 Impact environnemental Les ampoules LED ne contiennent pas de mercure, consomment moins et ne nécessitent quasiment pas d’entretien, contrairement aux ampoules traditionnelles. Elles s’inscrivent ainsi dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. Certes plus chères à l’achat, les ampoules LED permettent de réaliser d’importantes économies énergétiques et financières. II.5.4 Système de contrôle d’éclairage L’éclairage est le deuxième poste de consommation d’énergie électrique dans les bâtiments après le chauffage et la climatisation, il présente d’après l’AFE presque 37% de la consommation des bâtiments il est rentable donc d’essayer de diminuer cette consommation spécialement quand elle n’est pas nécessaire d’une manière automatique et autonome. Pour cette raison, nous avons proposé utilisé des systèmes de contrôle d’éclairage intelligent dans les salles de classes du bâtiment L1, il s’agit d’un système de contrôle semi-automatisé. II.5.5 Fonctionnement Ce système permet de garder un niveau d’éclairement fixe dans les locaux, il est composé de 4 volets principaux chacun est assuré par un organe spécifique : L'allumage/extinction (on/off) manuel à travers un interrupteur. Le Dimming (ou gradation), c'est-à-dire l'ajustement en continu de l'éclairage artificiel, consiste à contrôler le flux lumineux de la lampe en fonction des apports extérieurs. La détection de présence utilise un capteur qui détecte la présence ou l'absence d'un individu dans un espace spécifié, l'action sur les lampes peut être de trois types : l'allumage, l'extinction ou, dans certains cas, la gradation, la détection de présence
- 50. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 33 est assurée par un détecteur de présence double technologie (infrarouge + ultrasonique) qui garantit la détection des mouvements les plus faibles. La détection de lumière du jour va utiliser un capteur photosensible pour effectuer des actions sur l'éclairage artificiel en fonction de l'apport de lumière naturelle. Ces actions peuvent être de différents types : allumage, extinction ou gradation, elle est assurée à travers un détecteur de luminosité. Le système de gestion fonctionne seulement avec des luminaires led dimmable équiper d’un driver dimmable, le protocole qu’on à utiliser pour cette communication est le protocole DALI. II.5.5.1 Protocole DALI DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert et standard (IEC 62386) développé et soutenu par différents constructeurs de ballasts électroniques, qui permet de gérer une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus de communication à deux fils. II.5.5.2 Fonctionnalités Lorsque l’utilisateur entre dans la pièce il allume la lumière au moyen d’un interrupteur situé à l’entré. Si la lumière de jour est suffisante pour maintenir le niveau d’éclairement demandé dans la pièce le détecteur éteint automatiquement l’éclairage, en variation, il abaisse progressivement l’intensité des éclairages avant de l’éteindre pour ne pas donner aux occupants de l’espace une sensation d’obscurité. Figure 25 - Liaison DALI
- 51. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 34 Figure 26 - Système de Contrôle d'éclairage Figure 27 - Commande par ligne de Luminaires Si la lumière de jour décline le détecteur allume automatiquement l’éclairage, en variation, l’intensité s’adapte et complète la lumière extérieure pour obtenir la luminosité nécessaire (préprogrammer) afin d’éviter toute sensation d’éblouissement ou de sur éclairage. En quittant la pièce, l’utilisateur éteins la lumière avec l’interrupteur, s’il oublie, le détecteur éteindra automatiquement après un certain temps préprogrammé. Ce cycle est expliqué par la figure ci-dessous. Un seul détecteur est suffisant dans une pièce à condition de le mettre dans la zone la moins exposé à la lumière du jour mais plus on installe de détecteurs, plus la détection est fiable, plus on peut commander les luminaires puisque la lumière de jour n’est pas intégralement répartie dans un espace, donc un détecteur est associé à chaque trame de luminaires et mesure la présence et la luminosité. Le contrôleur variation régule chaque trame de luminaire et complète la lumière extérieure pour obtenir la luminosité nécessaire comme indique la figure ci-dessous :
- 52. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 35 II.6 Etude de l’éclairage intérieur Le calcul d’éclairement est adapté à un lieu, une utilisation, une tâche visuelle, les mêmes conditions se retrouvent de manière fréquente et il est donc possible d’établir une typologie des situations rencontrées en établissant des caractéristiques spécifiques pour chacune d’entre elle, cette typologie est établie par type de pièce selon la nature d’activité ou la tâche à exécuter dans cette pièce. A ce point, on doit déterminer les paramètres du local en question. II.6.1 Niveau d’éclairement (E) Le niveau d’éclairement moyen à maintenir dans une pièce est déterminer selon le type d’activité à exercer, il est fixé dans la norme d’éclairage intérieur NF EN 12 464-2, quelques exemples sont donnés dans le tableau ci-dessous. Tableau 8 - Eclairement moyen à maintenir en fonction de l'activité Noter que les éclairements à maintenir sont des valeurs minimales pour l’exécution de la tâche visuelle correspondant au type d’activité défini. En aucun cas on ne devra descendre en dessous de cette valeur. II.6.2 Caractéristiques du local On considère un local parallélépipédique de longueur et largeur a et b (figure28), Sauf cas particuliers, le travail ne s'effectue pas au sol mais à une certaine hauteur au-dessus de celui- ci. On appelle plan utile un plan fictif couvrant toute la surface de la pièce (donc de dimensions a x b) et situé par convention à 0,80 m du sol (sauf indications différentes).
- 53. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 36 Figure 28 - Paramètres du local On ne considérera donc jamais la hauteur totale d'un local mais : La hauteur h des luminaires au-dessus du plan utile. La hauteur h' de suspension des luminaires sous le plafond. Pour caractériser les dimensions (ou plus exactement les rapports de dimensions) d'un local, on utilise les deux notations suivantes : Indice du local 𝐾 = ∗ ∗( ) (II.1) Rapport de suspension 𝐽 = (II.2) Dans les tableaux qu’on trouve dans les fiches techniques des luminaires, il a été sélectionné dix valeurs standard pour K (0,6 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 et 5) et deux valeurs pour j (0 et 1/3). Dans les calculs, si l'on obtient des valeurs différentes, il faudra parfois interpoler. II.6.3 Les facteurs de réflexion Selon la couleur des plafonds, murs et sols la réflexion de la lumière deviendra plus ou moins importante, on le traduit dans le calcul par le coefficient de réflexion donné dans le tableau ci-dessous. Tableau 9 - Facteurs de réflexion Très clair Clair Moyen Sombre Nul Plafond 8 7 5 3 0 Mur 7 5 3 1 0 Plan utile 3 3 1 1 0 Le facteur de réflexion est exprimé en pourcentage, par exemple 753 signifie : Réflexion du plafond 70%, Réflexion des murs 50%, Réflexion du plan utile 30%
- 54. CHAPITRE II ETUDE D’ECLAIREMENT 37 II.6.4 Le facteur d’utilance (U) L’utilance est le rapport du flux utile (reçu par le plan utile) au flux total sortant des luminaires, il est déterminé à partir d’un abaque qu’on trouve dans la fiche technique du luminaire en connaissant l’indice du local K et les facteurs de réflexion, l’abaque ci-dessous est un exemple de tableau d’utilance. II.6.5 Le facteur de dépréciation (d) En cours d'utilisation, le flux lumineux émis par une lampe baisse : entre deux nettoyages, les surfaces des lampes et du luminaire s'empoussièrent ; les matériaux qui composent le luminaire peuvent vieillir ; les parois du local voient aussi leur couleur changer dans le temps. Le facteur compensateur de dépréciation est le chiffre par lequel il faut multiplier l'éclairement moyen à maintenir pour connaître le flux à installer initialement. Les conditions de la dépréciation varient avec la nature de l'activité exercée dans le local, la nature des lampes, la construction du luminaire, la fréquence des nettoyages, l’AFE indique les valeurs suivantes à titre indicatif. Tableau 10 - Facteur de dépréciation Nature de l’activité Niveau d’empoussièrement facteur de dépréciation Montages électroniques, locaux hospitaliers, bureaux, écoles, laboratoires Faible 1,25 Boutiques, restaurants, entrepôts, magasins, ateliers d’assemblage Moyen 1,4 Aciéries, industries chimiques, fonderies, polissages, menuiseries Elevé 1,65 Figure 29 - Facteur d'utilance