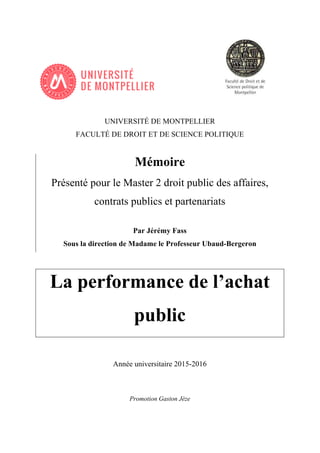
La performance de l'achat public
- 1. UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE Mémoire Présenté pour le Master 2 droit public des affaires, contrats publics et partenariats Par Jérémy Fass Sous la direction de Madame le Professeur Ubaud-Bergeron La performance de l’achat public Année universitaire 2015-2016 Promotion Gaston Jèze
- 2. 2
- 3. 3 À mon grand-père Jean,
- 4. 4
- 5. 5 REMERCIEMENTS Je voudrais tout d'abord adresser toute ma gratitude à la directrice de ce mémoire, le Professeur Marion Ubaud-Bergeron, pour sa confiance, sa disponibilité et son soutien tout au long de cette année, et plus particulièrement au cours de l’écriture de ce mémoire. Je désire aussi remercier le Professeur Guylain Clamour pour la confiance qu’il m’a accordée en me permettant de faire partie de cette formation exceptionnelle. Le partage de son expérience et sa bienveillance m’ont permis d’achever idéalement mon cursus universitaire. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à l’ensemble de la promotion « Gaston Jèze » du Mater 2 Contrats publics et partenariats, qui m’ont permis de vivre cette merveilleuse aventure humaine. Un grand merci tout spécialement à Léa Cadillon, Anaïs Calmettes, Alice Folscheid, Raphael Montels, Ferdi Youta et Lucas Dayet pour tous ces souvenirs et leur soutien dans l’écriture de ce mémoire. Je tiens à remercier tout particulièrement mes parents et Esther, qui m’ont toujours accompagnés. Je remercie également très sincèrement mon cousin Samuel et ma sœur Léa pour la relecture de ce travail et leurs conseils éclairés. Enfin, je tiens à témoigner toute ma gratitude à Luc, mon beau père, qui durant 8 mois m’a hébergé et épaulé, me permettant de me sentir chez moi, dans cette superbe ville de Montpellier.
- 6. 6
- 7. 7 AVERTISSEMENT La faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
- 8. 8
- 9. 9 SOMMAIRE INTRODUCTION PARTIE 1: LA NECESSAIRE CONSECRATION D’UNE IDENTITE JURIDIQUE POUR LA PERFORMANCE DE L’ACHAT PUBLIC Chapitre 1 : Les enjeux de la conceptualisation juridique de la performance Chapitre 2 : La recherche d’une obligation de performance de l’achat public PARTIE 2 : LA PRISE EN COMPTE DE L’EXIGENCE DE PERFORMANCE PAR LE DROIT DE L’ACHAT PUBLIC Chapitre 1 : La performance mise en œuvre « par » et « pour » le contrat Chapitre 2 : Du juriste au manager de l’achat public CONCLUSION TABLE DES MATIÈRES BIBLIOGRAPHIE
- 10. 10
- 11. 11 « Il est moins difficile d'élaborer des idées nouvelles que d'échapper aux anciennes. » John Maynard Keynes (1883-1946) Théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, Préface de la première édition anglaise (1936)
- 12. 12
- 13. 13 INTRODUCTION « Ce qui caractérise les méthodes des services publics, c’est l’existence d’un certain nombre de règles que les agents sont tenus de respecter en toutes circonstances ; au contraire le fondement essentiel des méthodes qui ont la faveur de l’industrie et du commerce, c’est l’absence de règles fixes. (…) Par suite d’une déformation progressive de la mentalité des fonctionnaires, le souci du respect des formes finit par devenir une obsession, qui rejette à l’arrière-plan celui de la bonne exécution elle-même ». C’est ainsi que dès 1930, Maurice Israël exprimait le manque de performance de l’achat public, dans sa thèse sur l’Etat acheteur1 . La liberté contractuelle de droit privé, comme les techniques managériales de ce secteur, tant lors de la passation d’un contrat, qu’à l’occasion de son exécution, doivent être une source d’inspiration pour un achat public qui se veut de plus en plus performant. Une problématique actuelle. La problématique de la performance de l’achat public n’est donc pas nouvelle, mais à l’heure où la situation des finances publiques locales et étatiques est particulièrement préoccupante, la recherche d’économie ressurgit de plus belle, au sein d’un poste de dépense particulièrement important puisque représentant près de 10% du PIB (190 milliards d’euros pour les achats des administrations publiques selon l’INSEE)2 . Si les acheteurs privés ont compris depuis longtemps que l’achat pouvait être un levier d’économie, cette considération était complètement absente des débats au sein du secteur public. Depuis une quinzaine d’années un changement de mentalité se met progressivement en place3 et s’est traduit sémantiquement dans la doctrine par l’abandon du terme de « commande publique », pour lui préférer celui « d’achat public ». Les marchés publics ne sont plus seulement juridiques, ils sont aussi économiques. Aujourd’hui néanmoins, Jean-Arthur Pinçon évalue encore entre 30 et 50 milliards, les économies envisageables dans les achats publics4 , si bien que d’importants efforts doivent 1 M. ISRAËL, L’Etat acheteur, PUF, 1930, p. 223. 2 Sénat, Mission commune d’information sur la commande publique, Rapport d’information n°82, M. BOURQUIN (dir.), 14 octobre 2015, p. 30. 3 F. LINDITCH, « Dix ans de commande publique », JCP A n° 43, 2012. 4 V. J.-A. PINÇON, Le gâchis – 30 milliards d'euros perdus par an dans les Achats Publics, l’Harmattan, 2015.
- 14. 14 encore être fournis. Il faut en effet dépasser complètement l’adjudication moyenâgeuse et son procédé unilatéral, pour faire pleinement la place au mode contractuel et à une passation, puis une exécution toutes deux placées sous le signe de l’efficacité, en matière de marchés publics5 . L’obstacle principal à ce nouveau paradigme est d’une part un droit des marchés publics inadapté à la performance6 , et d’autre part, des acheteurs qui ne sont responsables que de la conformité de leurs marchés, à un droit qui ne prône lui-même pas la performance7 . L’achat public. Les marchés publics « sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à (l’ordonnance du 23 juillet 2015) avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »8 Ces contrats sont inclus au sein de la notion de commande publique qui désigne au sens large l’ensemble des contrats permettant à la personne publique de satisfaire ses besoins. Même si les contrats répondant davantage à une logique concessive, qu’à celle de commande devraient être exclus d’une telle notion, aussi bien le juge que le législateur ou le gouvernement, ont une vision extensive de cette notion de commande9 . Cette étude se limitera pourtant aux marchés publics et ne s’attardera pas sur les efforts à faire en matières de performance pour les concessions, celles-ci demandant bien moins d’efforts en la matière. Les marchés publics correspondent peu ou prou à la définition juridique que l’on peut donner à l’action d’acheter dans le secteur privé, puisque l’achat se définit comme « une opération par laquelle une entreprise ou une personne physique – l’acheteur – acquiert auprès d’une autre entreprise ou d’une personne physique – le vendeur – la propriété de biens ou le bénéfice d’une prestation de service en contrepartie d’un règlement, dans des conditions négociées, d’un montant déterminé qu’elles ont accepté. »10 Pour désigner les marchés publics, il est donc de plus en plus fait allusion à la notion « d’achat public ». Cette évolution terminologique est aujourd’hui à l’œuvre au sein même des nouveaux textes relatifs aux marchés publics. Selon le Professeur Ubaud-Bergeron, ce 5 V. en ce sens : F. ALLAIRE, « Dépasser le droit des marchés publics », AJDA 2009, p.1696. 6 F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une rencontre impossible ? », RFDA 2014, p. 403. 7 V. en ce sens : A. TUECH, L’acheteur public : juriste et manager, Mémoire de fin d’étude dans le cadre du Séminaire Management des Organisations, IEP de Lyon, 2007, pp. 14-18. 8 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 4. 9 V. en ce sens : M. UBAUD-BERGERON, Droit des contrats administratifs, coll. Manuel, LexisNexis, 2015, p. 26. 10 J.-P. DENIS, A.-C. MARTINET, A. SILEM, Lexique de gestion et de management, Dunod, 9e éd., 2016, p. 8.
- 15. 15 changement sémantique illustre une prise de conscience, quant à la fonction économique de certains contrats publics, tels que les marchés publics11 . Le paradigme change. Une professionnalisation des acheteurs publics est en cours12 . Ces derniers sont l’équivalent des pouvoirs adjudicateurs définis aux articles 10 et 11 de l’ordonnance du 23 juillet 201513 et leur compétence juridique ne suffit plus. Désormais l’objectif lors de la passation d’un marché public n’est plus seulement de garantir sa régularité. Ces achats s’intègrent en effet au sein d’une fonction achat empruntée à la gestion privée, qui a pour but « de procurer à l’entreprise les valeurs d’exploitation »14 qui correspondent à « l’ensemble des stocks de matières, de produits ou d’emballages appartenant à l’entreprise et relatifs à son exploitation »15 . Cependant, à la différence du droit privé, les contrats d’achat public sont des contrats réglementés par des procédures de mise en concurrence strictes et contraignantes. La performance. Cette notion est habituellement absente des réflexions juridiques. Le terme est davantage employé dans un contexte artistique, sportif ou économique16 . Cette notion est surtout rattachée au vocabulaire managérial. Le management étant « l’Art de diriger en prenant en compte les contraintes immédiates sans pour autant perdre de vue les orientations souhaitables à long terme »17 , la performance est quant à elle l’objectif principal à ne pas perdre de vue lorsque l’on dirige une organisation. Les « contraintes immédiates », comme les « orientations » à long terme ont toutes les deux pour objet la performance. Cette affirmation ne semble cependant valoir qu’au sein d’entreprises privées, comme si la performance était une notion non seulement absente du droit, mais également étrangère au secteur public. La notion de performance est polysémique. Elle peut représenter à la fois, la mesure du résultat d’une action, l’action en elle-même, une action réussie18 . Elle désigne donc aussi bien l’objectif, que les moyens mis en œuvre pour l’atteindre. C’est à dire que la performance 11 M. UBAUD-BERGERON, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 27. 12 idem. 13 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 8. 14 J.-P. DENIS, A.-C. MARTINET, A. SILEM, Lexique de gestion et de management, op. cit., p. 9. 15 Ibid, p. 621. 16 J. CAILLOSSE, « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA 1999, p.195. 17 Web Dictionnaire Alternatives économiques. 18 H. MAHÉ DE BOISLANDELLE, Dictionnaire de Gestion, coll. Techniques de gestion, Economica, 1998, p. 319.
- 16. 16 doit inspirer aussi bien la politique (définition des objectifs), que la stratégie d’achat (actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs définis) d’une organisation. Plusieurs fonctions sont donc reconnues à cette même notion19 . D’abord, les économistes considèrent que la performance a une fonction d’objectif20 . Cet objectif lie l’efficacité à l’efficience. Efficace se dit d’une action, telle que celle d’acheter, « qui remplit bien sa tâche, qui atteint son but, qui aboutit à des résultats utiles »21 . Une action efficace est donc capable d’atteindre un objectif préalablement défini. Tandis qu’une action efficiente, se dit d’une activité « qui aboutit à de bons résultats avec un minimum de dépenses »22 . A la différence de l’efficacité, l’efficience s’intéresse donc aux moyens mis en œuvre et vise à obtenir le meilleur résultat possible avec les moyens mis à disposition. Ces deux adjectifs ne doivent pas être confondus et sont par ailleurs pleinement complémentaires. Ensuite la performance est un instrument de mesure. Sa fonction mesure est le corollaire de sa fonction d’objectif. Il s’agit de la « mesure ex post de résultats obtenus »23 , afin d’exprimer « le degré d’accomplissement des objectifs poursuivis par une organisation. »24 Cette mesure doit être effectuée objectivement, au moyen d’indicateurs25 . On préférera cette approche objective de la performance, plutôt que de voir la performance comme un véritable jugement de valeur, subjectif, par rapport à ce qu’on estime être un succès pour une organisation26 . Par contre, la performance en tant qu’action destinée à l’accomplissement d’objectifs trouvera sa place dans les développements ultérieurs. Il s’agit en effet de décrire le processus menant au succès. La performance a également une fonction de contrôle. La comparaison des résultats obtenus aux objectifs préalablement fixés doit également faire l’objet d’une analyse, qui doit amener à décortiquer l’activité en question, afin de distinguer les pans défaillants de l’activité, de ceux fonctionnant de manière optimale, comme le préconisait William Ouchi27 . 19 V. en ce sens : N. BERNARDINI, La performance et les contrats de la commande publique, Master 2 Droit des contrats publics et Droit public des affaires, Université D’Aix-Marseille, 2014, p. 14. 20 Cette vision de la performance est décrite au sein de : A. DESREUMAUX, Introduction à la gestion des entreprises, coll. Colin U, Armand Colin, 1992. 21 Larousse.fr 22 Ibid. 23 H. MAHÉ DE BOISLANDELLE, Dictionnaire de Gestion, op.cit., p. 319. 24 Ibid. 25 Cette vision de la performance est décrite au sein de : E. M. MORIN, A. SAVOIE, G. BEAUDIN, L’efficacité de l’organisation - Théories Représentations et Mesures, Gaëtan Morin éditeur, 1994. 26 H. MAHÉ DE BOISLANDELLE, Dictionnaire de Gestion, op.cit., p. 319. 27 W. G. OUCHI, « A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms », Management Science, Vol. 25, N° 9, 1979, pp. 833-848.
- 17. 17 Finalement, on pourra retenir pour cette étude, que la performance représente l’objectif principal pour une organisation, dont la réalisation est directement liée aux indicateurs choisis. Or ces indicateur doivent permettre d’apprécier la situation – performante ou non – de l’organisation en question en permettant de se concentrer sur certains aspects précis de l’activité. Au sein de ces indicateurs, un certain nombre de sous-objectifs sont prédéfinis et comparés ex post aux véritables résultats obtenus. Cette démarche de mesure est en elle-même performante et doit mener à un certain nombre de conclusions organisationnelles d’une ampleur plus ou moins grande. Ainsi la performance loin d’être un « mot éponge » est un ensemble. La performance c’est une démarche au service d’un objectif. Cependant, il s’agit surtout d’une exigence pratique, car loin d’avoir sa propre identité juridique, la source de la performance semble être davantage le bon sens organisationnel, que le respect d’une obligation. L’objectif de performance appliqué à l’achat public. Certes la performance est une démarche au service de l’efficacité et de l’efficience mais cela ne nous indique pas pour autant au nom de quel but spécifique la démarche de performance doit être mise à profit en matière d’achat public. Ecologie ? Réduction des coûts ? Soutien à l’économie ? Réputation ? Respect du droit ? La commande publique a plusieurs objectifs qui sont apparus progressivement et qu’il faut présenter par ordre chronologique. De prime abord, la commande publique a pour objet de répondre aux besoins de l’administration en cherchant à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Le second objectif de la commande publique est issu du droit européen. Il s’agit du principe de non-discrimination ou d’égalité concurrentielle. Enfin, le troisième objectif, qui est le plus récent a pour objet le développement durable et repose sur des considérations économiques, sociales ou environnementales28 . Dès lors, avec autant d’objectifs, la performance doit être entendue globalement. Ainsi la démarche de performance s’appliquera à chacun de ces objectifs. Cependant, chacun de ces objectifs n’est pas entièrement compatible avec les deux autres. De même, la poursuite de plusieurs objectifs sans une vision directrice, serait une démarche tout sauf performante. Il faut un objectif principal qui sans empêcher l’accomplissement des deux autres, se situera hiérarchiquement au-dessus d’eux. Or pour une entreprise la performance équivaut à l’amélioration du rapport entre valeur et coût pour tendre à une création de valeur maximale. 28 S. THELLIEZ-HUGODOT, La définition de la commande publique par le pouvoir adjudicateur, Mémoire M2, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2013.
- 18. 18 L’achat étant un acte économique par essence, transposée pour la fonction achat et uniquement pour elle, cette vision de la performance dans le secteur public ne semble pas incongrue, surtout que l’objet principal de la commande publique est de répondre aux besoins de la personne publique. Ainsi un achat public performant désigne le fait « dépenser moins en améliorant la qualité des prestations livrées »29 . C’est un parti pris. Il s’agit d’une vision pragmatique de l’achat public qui n’est pas incompatible avec la poursuite des objectifs. Seulement, la priorité donnée à ces impératifs de coût et de qualité protègent les intérêts de l’Administration, et surtout, contribue à inscrire pleinement l’Administration dans une économie de marché, c’est à dire un système économique au sein duquel les agents économiques, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’individus et les organismes publics, ont la liberté de vendre et d’acheter des biens, des services ou des capitaux, en agissant en fonction de leurs propres intérêts30 . Un droit des marchés publics a évolué loin des considérations performancielles. En 1256, Saint Louis ordonne à ses officiers de jurer qu’ils adjugeront tous les contrats d’exploitation du domaine royal en les vendant au meilleur profit31 . C’est la première définition de la commande publique. L'administration devait donc attribuer le marché au candidat qui formulait « l'offre de faire la meilleure chose au meilleur compte »32 . Seul le prix avait de l’importance. Progressivement cette stratégie d’achat est critiquée. Le maréchal Vauban en 1686, au milieu du chantier des fortifications qui ont fait sa renommée, exprime des remontrances au Ministre de la guerre de Louis XIV, Louvois. Il dénonce alors ce culte du bas prix et appel déjà de ses vœux, en substance, de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse33 . Malgré ces remontrances, le droit des marchés publics s’est bien construit sur ces bases, en continuant d’encourager le choix de l’offre la moins-disante. Il s’agit en effet pour les agents publics de se limiter à choisir l’offre proposant le prix le plus bas. Cette construction s’illustre parfaitement par deux lois du 19ème siècle. L'ordonnance royale du 4 29 F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une rencontre impossible ? », RFDA 2014, p. 403. 30 A. NACIRI, Traité de gouvernance d’entreprise, coll. Comptabilité, Presse de l’Université du Québec, 2011, p. 42. 31 V. en ce sens : X. BESANCON, Essai sur les contrats de travaux et de services publics, coll. Bibliothèque de Droit Public, LGDJ, t. 206, 1999. 32 J.-N. GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, 2e éd., 1784-1785, in F. ALLAIRE, « Dépasser le droit des marchés publics », art. préc. 33 . BLANCHARD, Vauban, Fayard, 2007, in S. BRACONNIER, Précis du droit des marchés publics, le moniteur, 2e éd., 2009.
- 19. 19 décembre 183634 , si elle utilise pour la première fois des mots tels que « concurrence » ou « publicité », ne s’éloigne pas pour autant de cette philosophie35 . Cette tendance est un non-sens économique, qui rejoint un impératif de « protection des deniers publics ». Cet objectif semble louable au premier abord, mais il se distingue pourtant d’une vision performancielle de l’achat public. Il faudrait en effet lui préférer un objectif de « bonne utilisation des deniers publics ». « Bonne utilisation » et « protection » sont deux notions proches, qui sont d’ailleurs le plus souvent confondues, mais la bonne utilisation des deniers publics suppose une prise en compte de la qualité, parallèlement à celle du coût lors d’un achat, ce qui n’est pas le cas de la notion de protection qui se concentre sur la question du prix36 . Pendant plus de 150 ans, les soucis rencontrés au cours de l’exécution des marchés publics n’ont pas suffit à permettre une évolution du droit. La comparaison de ces difficultés, apparaissant lors de l’exécution contractuelle et la somme extrêmement faible du marché, suffisait pour le choix de l’offre la moins disante à remporter l’adhésion générale. La logique de moyen régnait en maître. Le tournant de la performance publique. Dans les années 90, plutôt que de réduire la voilure de l’Etat comme dans les années 80, on cherche à mettre en œuvre le « mieux- état ». Une exigence de qualité des services publics commence à se mettre en œuvre. Les dettes publiques, les affaires de corruption et le développement du marché intérieur européen vont avoir raison de ces pratiques dispendieuses en matière d’achat public. Cette exigence de qualité des services publics va nécessairement atteindre les marchés publics, puisqu’un tel contrat est contrat administratif qui rappelons-le n’est autre « qu’un procédé de technique juridique mis à la disposition des agents publics pour assurer le fonctionnement régulier et continu des services publics (…). La justification de ce procédé technique spécial est dans la notion de service public. »37 34 Ordonnance du roi portant règlement sur les marchés passés au nom de l’Etat, prise en application de l’article 12 de la loi du 31 janvier 1833 pour l'approvisionnement en fournitures, la réalisation de biens et de prestations de services pour le compte de personnes publiques, in A.-A. CARETTE, Lois annotées: ou Lois, décrets, ordonnances, avis du Conseil d'État, etc. (1831-1844), Société Anonyme du Recueil Sirey, t. 2, 1945, pp. 341- 342. 35 V. en ce sens : P. BEZES, F. DESCAMPS, L'invention de la gestion des finances publiques : Elaborations et pratiques du droit budgétaire et comptable au XIXe siècle (1815-1914), coll. Histoire économique et financière de la France, Comité pour l'Histoire économique et financière, 2010, pp. 201-208. 36 Ibid. 37 G. JÈZE, « Le régime juridique du contrat administratif », RDP 1945, p. 251.
- 20. 20 En 1992, la recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse apparaît pour la première fois en droit européen38 , mais c’est seulement en 2001 que le premier Code des marchés publics eurocompatible apparaît en France et promeut le choix de l’offre la mieux- disante. 2001 c’est également l’année de la LOLF39 . Cette loi organique va entièrement refonder le droit budgétaire français et imposer dans l’élaboration des lois de finances une « logique de performance ». S’inspirant de la loi américaine de 1993 intitulée Government Performance and Results Act, la gestion des finances de l’Etat change totalement, passant d’une logique de moyen à celle de résultat. L’efficacité de l’action publique, ainsi que son efficience tendent alors à s’imposer. Plus généralement, depuis plus de trente ans la simplification et la modernisation de l’action publique par des réformes telles que la RGPP ou la MAP contribuent à alimenter la naissance d’une gestion publique performancielle. Aussi, le droit des marchés publics tente-t-il depuis 2001 de se renouveler autour d’un nouvel objectif, mais des résistances fondamentales demeurent. Un droit des marchés publics fondamentalement non performant. Même si le droit européen a permis au droit français d’adopter une approche mieux-disante lors d’une procédure de passation d’un marché public, ce droit ne s’est pas pour autant fondé sur une exigence de performance pour cela. Par contre, le droit national des marchés publics, même si il l’exprimait de manière paradoxale, en exigeant de ne s’intéresser qu’au prix, avait conscience dès le départ de l’impact de l’achat public sur les dépenses publiques. Le droit européen des marchés publics partant du postulat que les personnes publiques étaient susceptibles de faire des choix davantage politiques, qu’économiques lors de la passation de ses contrats d’achat, a soumis les organismes publics à un droit de la mise en concurrence. De cette façon le principe de libre concurrence pouvait être respecté et le marché intérieur être achevé, grâce à la mise en œuvre effective d’un principe de non- discrimination. Il faut finalement observer qu’un compromis entre les fondements du droit des marchés publics en droit français et ceux du droit européen se met progressivement en place. Le Code de 2001 puis plus explicitement ceux de 2004 et 2006 ont formellement fait découler les règles de mise en concurrence, d’une exigence d’efficacité de la commande 38 Dir. 92/50/CEE du conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, art. 24. 39 L. organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, arts. 48, 51 et 54.
- 21. 21 publique et de bonne utilisation des deniers publics. L’illustration de ce compromis purement formel se trouve de nouveau à l’article 1er de l’Ordonnance de 2015 relative aux marchés publics40 . Les principes fondamentaux de la commande publique, desquels découlent l’ensemble des règles relatives aux marchés publics sont donc formellement fondés sur une exigence de performance. Cette précision normative reste cependant aujourd’hui purement théorique, puisque le droit des marchés publics, et par voie de conséquence l’action concrète des acheteurs publics, demeure un droit européen qui semble imperméable à une véritable considération d’efficacité et d’efficience, car il se focalise sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Il faudrait pourtant achever ce compromis. Le droit des marchés publics devrait se construire autour d’une exigence de performance, qui sans ignorer d’autres impératifs tels que le marché intérieur ou la lutte contre la corruption, pourrait permettre une prise en compte légitime des intérêts de l’Administration. Ainsi un droit des marchés publics performant pourrait naître et l’acheteur public, plutôt que de se focaliser sur la conformité des procédures de passation aux textes, pourrait devenir un véritable manager. La responsabilisation des acheteurs publics : la performance par un changement du droit. Afin de mettre en place un achat public performant, il faut donc responsabiliser – au sens de la responsabilité en tant que notion juridique stricto sensu – les acheteurs publics non plus uniquement pour veiller à la conformité de leurs contrats au droit des marchés publics, mais aussi quant à l’efficacité et l’efficience de leurs achats. De même, tant le pouvoir exécutif que le législateur qu’ils soient européens ou nationaux doivent avoir à cœur de prévoir des procédures efficaces, simples et permettant un achat rationnel. Le droit doit être l’outil de ce renouveau de l’achat. Aussi une véritable obligation juridique de performance, comme fondement du droit des marchés publics, permettrait cette responsabilisation des acheteurs publics. Ces derniers veilleraient alors à élaborer une politique d’achat public performante, c’est à dire que dans l’exercice de sa fonction achat, la collectivité publique devrait établir certains objectifs de performance précis, qui seraient sources de véritables économies. 40 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 1er : « Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
- 22. 22 De plus, avec une obligation de performance fondamentale à respecter, le droit des marchés publics, qu’il soit élaboré par les instances européennes et nationales, deviendrait de fait moins contraignant et la liberté contractuelle, sans pour autant devenir illimitée, serait revalorisée. La rencontre de l’offre et de la demande serait alors optimisée et les acheteurs ne se focaliseraient plus uniquement sur l’exigence de sécurité juridique, pour devenir non plus seulement des juristes, mais de véritables managers de l’achat public. L’avènement du management de l’achat public : la performance par un changement des pratiques d’achat. Une fois la politique d’achat mise en œuvre, on peut enfin s’interroger sur la mise en place concrète de techniques, procédures et autres comportements destinés à l’accomplissement des objectifs préalablement définis. Vient donc le temps d’une vision stratégique de l’achat permise par de nouvelles pratiques plus performantes. Ce renouvellement – suffisant – des pratiques nécessite la conceptualisation juridique de la notion de performance en tant que véritable obligation, ainsi que son élévation au statut de fondement du droit des marchés publics. Néanmoins, cette refondation semble peu probable à court terme, au regard de la récente refondation du droit de la commande publique initiée par les directives européennes de 201441 , l’ordonnance relative aux marchés publics de 201542 et le décret d’application de ladite ordonnance de 201643 . Il est regrettable qu’à l’heure d’une refondation de ce droit, la performance ne se soit pas imposée pleinement. Pour autant, sans être optimale, l’évolution permise par l’émergence de nouvelles techniques, grâce à l’aval des nouveaux textes, va dans le bon sens. Au cœur de ces textes, des techniques en provenance du secteur privé ou entièrement publiques ont en effet été permises, voire encourager à l’image de la dématérialisation, du sourcing, du coût du cycle de vie ou du recours à la négociation qui a été étendu. L’acheteur public se transforme peu à peu en un véritable manager, même si des efforts doivent encore être fournis. Plutôt que de s’imposer par le haut, la performance est donc mise en œuvre par le bas, par la pratique, de manière concrète au niveau des acheteurs et le droit prend en compte à 41 Dir. 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ; Dir. 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; Dir. 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. 42 O. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 43 D. n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
- 23. 23 posteriori certains de ces changements. Ce procédé était le plus réaliste et permettra peut-être un jour à la performance de s’imposer comme nouveau paradigme de l’achat public. Le problème d’une telle évolution est qu’elle génère un manque de cohérence et d’efficacité retardant l’implantation d’une vision performante. L’importation de la performance ne sera pas optimale. Autrement dit, elle ne sera pas elle-même performante. La performance de l’achat public est, au même titre que l’achat, un objet de politique publique. Il faut donc que la politique publique consistant à rendre l’achat performant, soit elle même performante. Problématique. C’est donc en ayant conscience que la performance doit agir à deux niveaux pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’acheter de manière performante, qu’il faut se demander comment la reconnaissance juridique de la performance permettrait-elle de venir à bout des difficultés que rencontrent les acheteurs publics lors de l’élaboration d’une stratégie d’achat efficace et efficiente ? Plan du mémoire. A cette question il convient de répondre que la notion juridique de performance doit prendre la forme d’une obligation afin de définir une politique d’achat performante (Partie 1), et ainsi encourager l’acheteur public à se responsabiliser pour mettre en place une stratégie d’achat performante (Partie 2).
- 24. 24 Partie 1: La nécessaire consécration d’une identité juridique pour la performance de l’achat public Plan. Définir une politique d’achat performante revient à fixer des objectifs pour l’acheteur. Certes l’objectif principal pour ce dernier est d’être performant, mais comment rendre cet objectif effectif ? Pour cela il faut avant tout qu’il se sente obligé de l’être. L’émergence d’une obligation de performance devient donc essentielle pour guider ensuite les acheteurs publics dans l’élaboration de leur stratégie d’achat qui vise quant à elle à permettre l’accomplissement de cet objectif de performance de l’achat public. La difficulté de la consécration juridique de la performance réside dans le fait que la performance est d’une part un concept économique, qui d’autre part s’inscrit à l’origine dans le secteur privé. De plus, lorsqu’elle est inculquée à l’achat public, celle-ci doit nécessairement s’entendre globalement. Il demeure pourtant que le droit des achats publics évolue en prenant appui sur une exigence fondamentale, qu’il reste à définir. Il vient que l’incorporation de la performance au droit des marchés publics, suppose au préalable de prendre conscience des enjeux d’une telle définition. En premier lieu, du fait de sa nature publique, l’obligation juridique de performance implique de dépasser l’inadéquation fondamentale entre droit public et performance. En second lieu, pour définir cette obligation de performance, il faudra être attentif à ne pas laisser l’objectif de performance se globaliser à l’excès, en encourageant un achat à la croisée des intérêts de la société, de l’environnement et de l’Administration. (Chapitre 1). La performance économique trouve son origine dans la modernisation de l’Etat qui a directement impacté la droit financier public. De même, le principe de libre concurrence a progressivement démontré qu’il ne servait pas uniquement l’objectif d’achèvement du marché intérieur, mais bien une meilleure utilisation des deniers publics, en garantissant l’efficacité de la commande publique. Aussi avec de tels fondements, il est judicieux de s’interroger sur les contours que pourrait adopter une obligation de performance de l’achat public si elle devait un jour apparaître explicitement dans le droit positif (Chapitre 2).
- 25. 25 Chapitre 1 : Les enjeux de la conceptualisation juridique de la performance Plan. Dans la perspective de définir juridiquement la performance de l’achat public, il semble primordial de poser un cadre à cette réflexion. D’abord, un achat public efficace et efficient revient à imposer un objectif de performance à l’action publique, ce qui implique une compatibilité entre le droit administratif et cette exigence, au moins en ce qui concerne la fonction achat de l’Administration (Section 1). Mais ce n’est pas le seul enjeu auquel il faut faire face. La performance de l’achat public s’entend globalement en raison du développement durable que les personnes publiques doivent servir. Cela suppose de parvenir à un achat équitable qui sera efficace tant pour la société et l’environnement, que pour le pouvoir adjudicateur (section 2). Section 1. Une performance publique Plan. Bien que la modernisation de l’Etat soit en marche, la nature réfractaire à toute performance du droit administratif demeure (I). La spécificité des contrats publics d’achat permet cependant une rencontre de la performance et du droit applicable à l’Administration (II) I. L’idée contre-nature d’une gestion publique performante Plan. Le droit administratif semble réfractaire à toute gestion publique performante (A), pourtant une gestion publique performante va finir par s’imposer (B). A. Le droit administratif, un droit réfractaire à l’idée de performance La performance réduite au statut de donnée scientifique. La gestion publique se définit comme « l’ensemble de pratiques ou de connaissances théoriques ou techniques relatives à la conduite des organisations »44 , qui sont en l’occurrence publiques. Il s’agit donc, au premier abord, davantage de « science administrative » que véritablement de « droit 44 P. BEZBAKH, S. GHERARDI, Dictionnaire de l'économie, coll. À présent, Larousse, 2011, p. 358.
- 26. 26 administratif » 45 . Les deux matières sont initialement distinctes46 . Pourtant, l’analyse du droit administratif renferme nécessairement une réflexion autour de l’Administration en tant qu’entité47 , voire même le supplante pour devenir véritablement le « droit de l’action publique »48 . Il reste que les réflexions autour de la prise en compte d’une exigence de performance dans le fonctionnement des administrations restent néanmoins le plus souvent réservées à la science administrative. L’évaluation des performances des politiques publiques, telle que la performance de l’achat public, n’est pas juridique49 . Le droit administratif semble donc impropre à accueillir de telles exigences. Dès lors, les réflexions autour du rendement ou de l’efficacité de l’action administrative restent résiduelles50 . Le constat : la performance, un objectif secondaire pour le droit administratif. « Le droit administratif français n'a jamais eu le rendement pour préoccupation centrale. »51 Le meilleur exemple de cette opposition farouche est le droit de la fonction publique. Il se pose en effet la question depuis plusieurs années de l’instauration d’un « véritable management de la fonction publique »52 , mais celui-ci doit faire face à plusieurs obstacles statutaires comme « la sécurité de l'emploi (…), le régime disciplinaire inadapté aux exigences d'une gestion dynamique des ressources humaines ou le système de la notation indifférent à la nécessaire rétribution des mérites (…), etc. »53 . A côté de ces réflexions autour du management de la fonction publique, d’autres difficultés juridiques ont été rencontrées par les personnes publiques, notamment pour valoriser leurs propriétés avec la règle de l’inaliénabilité du domaine public, ou pour faire coïncider le principe de libre concurrence européen avec la notion de puissance publique. C’est ce qui a pu faire dire respectivement aux professeurs Chevallier et Caillosse que le droit 45 J. CAILLOSSE, « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA 1999, p.195. 46 A.-F. VIVIEN, « Les études administratives », 1845, in P. CHRETIEN, N. CHIFFLOT, M. TOURBE, Droit administratif, coll. Université, Sirey, 14e éd.,2014. 47 J. CAILLOSSE « Sous le droit administratif, quelle(s) administrations(s) : réflexion sur l'enseignement actuel du droit administratif », Mélanges Gustave Peiser, coll. Droit public, P.U.G. Grenoble, 1995, p. 63. 48 P. CHRETIEN, N. CHIFFLOT, M. TOURBE, Droit administratif, op. cit., p. 41. 49 J. Caillosse, « Le droit administratif contre la performance publique ? », art. préc. 50 Ibid. 51 Ibid. 52 Ibid. 53 Ibid.
- 27. 27 administratif était un « îlot à part dans la société »54 et un « pôle de résistance »55 à toutes avancées des préoccupations relatives à la performance. Cette résistance devrait avoir pour conséquence de garantir le règne de la bureaucratie, en tenant l’entreprise privée à l’écart de la gestion de l’intérêt général. Il peut ainsi être observé une distinction stricte des principes de gestion privée et publique56 , qui illustre la difficile appréhension de la performance par le droit administratif. Les raisons de la difficile appréhension juridique de la performance par le droit administratif. « Le droit administratif tend ainsi à être perçu comme un ensemble de règles rigides et obsolètes, bloquant l'indispensable modernisation administrative et freinant le dynamisme économique et social »57 . A l’origine de cette difficile appréhension on trouve nécessairement la définition du droit administratif. Ce droit peut se définir, au sens large, comme le droit de l’Administration, comprenant l’ensemble des règles de droit relatives à son activité58 . En retenant une telle conception, les principes de gestion publique pourraient alors s’inscrire dans le champ d’application de ce droit qui devrait s’adapter aux exigences de gestion, telle que la performance. C’est cependant une conception bien plus restrictive qui triomphe habituellement59 . Dans un sens plus circonscrit, le droit administratif se définit par défaut. Il correspond en effet à l’ensemble des règles dérogatoires du droit privé. La pénétration du droit administratif par des exigences du secteur privé semble alors exclue par essence. Le droit administratif est exorbitant et rien qu’exorbitant. Son autonomie suppose qu’il se façonne lui-même. Ses sources juridiques lui sont propres. Aussi les fondements existants, qui composent le socle de ce droit en deviennent des obstacles obligés à toute nouvelle notion. Or la performance est une notion qui est au départ économique, propre à la gestion privée et au service du profit des entreprises. Celle-ci ne semble pas armée, en théorie, pour intégrer le corpus des règles administratives. C’est donc bien l’exorbitance du droit public qui fait en théorie obstacle à une prise en compte de la performance, puisque celui-ci se défini par opposition à l’entreprise 54 J. CHEVALLIER, « Changement politique et droit administratif », in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 293-326. 55 J. CAILLOSSE, « Le droit administratif contre la performance publique ? », Art. préc. 56 J. CHEVALLIER, « Changement politique et droit administratif », Art. préc. 57 Ibid. 58 Ibid. 59 R. CHAPUS, Droit Administratif, Montchrestien, coll. Domat, t. 1, 15e éd., 2001.
- 28. 28 et au marché. Il puise sa raison d’être au sein de la distinction public-privé, alors qu’il ne devrait s’agir que « d’un univers mental »60 , d’un dualisme « superficiel » et non d’une dissociation pouvant se vérifier matériellement. La nécessité de dépasser la distinction entre secteur privé et secteur public. Il faudrait donc se contenter théoriquement d’une approche purement gestionnaire de la performance publique sans cesse freinée par les résistances du droit administratif, car comme le souligne Jacques Chevallier en parlant de l’Administration « l'amélioration de ses performances et de ses résultats (passe) par la mise en cause de ses privilèges et par sa soumission au droit commun. »61 Ainsi cette nouvelle démarche de performance revient certes à s’inspirer des méthodes du secteur privé, mais implique également une soumission à certaines règles de droit privé. En dépit de ce que peut affirmer le professeur Linditch qui soutient que « le droit peut toujours évoluer (…) cette quête de la performance suppose surtout que soit diffusée une nouvelle culture financière et budgétaire dans tous les services, techniques, mais également juridiques »62 , c’est bien la conceptualisation juridique de la notion de performance qui permettra une prise en compte, elle même efficace, des exigences qu’elle suppose. La première condition d’un tel changement est l’évolution vers une autre conception du droit administratif, en renouvelant ses fondements et derrière ceux-ci, la conception même de l’Etat, puisque le droit administratif a ceci de « miraculeux »63 , qu’il est produit par l’Etat qui s’y soumet lui-même ensuite (B). B. La modernisation de la gestion publique Le nécessaire renouvellement du droit applicable aux administrations. La performance, en tant que notion non plus économique mais juridique, ne pourra être théorisée qu’au sein du « droit commun »64 , au sens d’un droit mixte, rassemblant l’ensemble des règles applicables aussi bien à l’Administration, qu’aux particuliers, renonçant ainsi à une 60 J. CAILLOSSE, « Le droit administratif contre la performance publique ? », art. préc. 61 J. CHEVALLIER, « Changement politique et droit administratif », art. préc. 62 F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une rencontre impossible ? », art. préc. 63 P. WEIL, D. POUYAUD, Le droit administratif, coll. Que sais-je, PUF, 24e éd., 2013. 64 C. EISENMAN, « Droit public, droit privé », in C. EISENMANN, Ecrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idée politique, Textes réunis par C. LEBEN, éd. Panthéon-Assas, 2002, p. 94 et s.
- 29. 29 quelconque « autonomie » du droit administratif, qui ne serait qu’un « dogme faux »65 comme le remarquait le professeur Eisenmann. Le prérequis consistant à dire que l’Administration est soumise uniquement à « un corps de règles ayant son propre système de sources »66 ne serait donc plus retenu. Aussi en considérant le droit administratif comme n’étant pas autonome, la pénétration d’une exigence tenant davantage à la gestion privée ne serait alors plus qu’une question de volonté, puisque faire valoir une incohérence entre cette exigence et les fondements du droit administratif deviendrait inutile. Si cette question conceptuelle et très théorique, peut sembler superflue, elle est pourtant centrale au regard de l’inadéquation empirique des principes du droit administratif avec une vision performancielle de l’action administrative. Cette conception ne suivrait plus la dichotomie classique de notre ordre juridique. Au regard, de l’évolution de la gestion publique, une révolution est en marche puisque le renouveau de cette matière pousse progressivement le droit encadrant l’action publique, à la prise en compte d’exigences inspirées de la gestion privée. L’Etat et ses services publics se modernisent. Vers une réduction de la place de l’Etat: De 1945 à 1990. La modernisation de l’Administration est une préoccupation qui date du lendemain de la libération. Depuis 1945, les priorités pour l’Administration, dans le cadre de cette rénovation, ont évoluées et cette recherche d’efficience a varié dans son objet au rythme des évolutions du rôle de l’Etat tant socialement, qu’économiquement67 . D’abord il s’est agit de reconstituer le lien social (IVe République), ensuite il a fallu garantir le dynamisme des activités économiques ayant « le caractère de service public national »68 (Début de la Ve République), puis ce fut au tour du lien entre usagers et services publics de faire l’objet d’un renforcement (Années 60), qui aboutit à la création des premières autorités administratives indépendantes, dans les années 70 (CNIL et CADA). A partir des années 80, et suites aux difficultés économiques qui ont suivies les deux chocs pétroliers des années 70, l’Etat a dû soutenir l’économie et accompagner socialement le chômage de masse, le plaçant dans une situation budgétaire et financière préoccupante. La réforme administrative va alors se muer en une véritable réforme de l’Etat. Elle a pour 65 C. EISENMAN, « Un dogme faux : l’autonomie du droit administratif », in Ecrits de droit administratif, Textes réunis par N. CHIFFLOT, Dalloz, 2013, p. 452. 66 Y. GAUDEMET, A. de LABAUDERE, Traité de droit administratif, T. 1, LGDJ 16e éd., 2001. 67 G. J. GUGLIELMI, G. KOUBI, Droit du service public, coll. Domat, Montchrestien, 3e éd., 2011, p. 78. 68 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 9.
- 30. 30 objectif l’efficacité de l’Etat et des services publics, en réponse à la nécessité de réduire le déficit budgétaire, en limitant les dépenses de l’Etat, ou en tout cas, en les rationalisant. Progressivement « l’Etat régulateur » va s’imposer au dépend de « l’Etat providence », rejoignant ainsi une conception libérale du marché qui se développe à la même période en Europe. L’interventionnisme social et économique de l’Etat s’en trouve réduit, au profit de la régulation de secteurs économiques, autrefois directement géré par l’Etat. Il s’ouvre alors une période de privatisation d’un certains nombre d’activité et de services publics, entre 1986 et 1988, sous la houlette d’Edouard Balladur, ministre de l’économie du gouvernement de Jacques Chirac. Finalement, ces balbutiements autour des frontières de l’Etat, portent en eux une volonté de changement de gestion du service public. Une réflexion sur la qualité des services publics : des années 90 à nos jours. Ainsi, à partir des années 90 un discours sur les moyens d’aboutir à un « mieux de l’Etat » va prendre de l’ampleur, avec un objectif de « qualité », sous-jacent69 . A la suite d’un rapport de mai 199470 , une circulaire fut prise en 1995 par Alain Juppé alors Premier Ministre71 . Elle avait pour objet de clarifier les missions de l’Etat, de déléguer des responsabilités, etc. Mais surtout, cette circulaire posait comme objectif : la rénovation de la gestion publique. Dès lors, c’est bien la recherche de performance des services publics qui est ici visée. Ce texte, concernait essentiellement la modernisation de la gestion des fonctions publiques, mais formalise une prise de conscience générale. Le paradigme change. Il ne s’agit plus de raisonner sur les défaillances du marché nécessitant un interventionnisme étatique, mais bien sur les défaillances de l’Etat lui-même qu’il faut résoudre72 . La solution à ces défaillances consiste alors à importer dans le secteur public les méthodes de gestion du secteur privé, afin d’augmenter l’efficacité concernant les « processus de production »73 des services publics. Cette nouvelle forme de « privatisation » concernait la gestion publique des ressources humaines et tentait de résoudre la crise de délimitation entre les secteurs public et privé74 . 69 À l’image du Rapport de la Commission présidée par Y. CANNAC, La qualité des services publics, La Doc. fr., 2004. 70 M. PICQ, L'Etat en France : servir une nation ouverte sur le monde, Rapport au Premier ministre, La Doc. fr., 1994. 71 Circ., 26 juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l'Etat et des services publics. 72 M. BACACHE-BEAUVALLET, Où va le management public ?, coll. Positions, Terra Nova, pp. 14-15. 73 Ibid., p. 10. 74 V. en ce sens : R. LAUFER et A. BURLAUD, “Management public“, gestion et légitimité, Dalloz, 1980.
- 31. 31 Place au nouveau management de l’achat public. Ces réflexions tenant à la rénovation de la gestion publique se rejoignent au sein de la notion plus large de « new management public » qui se défini comme « l’ensemble des processus de finalisation, d’organisation, d’animation et de contrôle des organisations publiques visant à développer leurs performances générales et à piloter leur évolution dans le respect de leur vocation »75 . Il s’agit de la gestion des agents publics (notion de mérite, l'individualisation des rémunérations, l'appréciation du personnel sur la base des entretiens annuels d’évaluation, etc.), de la gestion financière et comptable (analyses en termes de « coûts – performances » des activités). Il faut également ajouter la prise en compte du développement durable puisque l’objectif de performance s’est globalisé76 . Ces trois sous-ensembles devant aller dans le sens d’une réduction des coûts77 . Lorsque l’on met bout à bout les objectifs d’externalisation et d’efficience interne des services publics, il apparaît une nouvelle problématique : la performance des contrats de la commande publique. La question de l’efficacité d’une externalisation d’un service public, sous forme de délégation contractuelle, n’est pas ici questionnée et a déjà fait l’objet de réflexions quant aux garde-fous nécessaires à sa mise en place78 . Pour autant, l’achat public doit lui-même faire l’objet d’une réflexion sur son efficacité, afin que la réforme de l’Etat puisse un jour aboutir. L’heure est donc au nouveau management de l’achat public. Ainsi après s’être concentré sur l’efficacité des services publics quant à leur « production », il est désormais temps de s’interroger sur l’efficacité de ces services publics quant à leur « consommation », prérequis nécessaire à toute « production ». Surtout que l’achat public semble pouvoir être le domaine où l’alliance entre performance et secteur public pourrait avoir lieu sur le terrain non plus gestionnaire, mais bien juridique (II). 75 A. BARTOLI, « Le management dans les organisations publiques », Dunod, coll. Management public, 2e éd., 2005, p. 98. 76 V. infra. 77 Y. PESQUEUX « Le "nouveau management public” (ou New Public Management) », 2006. En ligne : http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/51/08/78/PDF/Lenouveaumanagementpublic.pdf. 78 V. en ce sens : J.-P. COLSON, P. IDOUX, Droit public économique, coll. Manuel, LGDJ, 7e éd., 2014, pp. 269-272.
- 32. 32 II. « La rencontre »79 naturelle de la performance et du contrat d’achat public Plan. Le marché public est un contrat formalisant une relation de collaboration avec un opérateur économique ayant pour objet de répondre aux besoins de l’Administration par l’achat de biens, de services ou de travaux. Dès lors, tant la forme contractuelle (A), que la nature économique de cette collaboration (B), doivent permettre la prise en compte d’une exigence de performance par l’achat public, même s’il s’inscrit dans le cadre d’une gestion publique. A. Le contrat, un outil de performance publique Le contrat, l’acte juridique à « la mode »80 , au même titre que la performance. Le contrat a « une valeur symbolique »81 , puisqu’il représente l’outil juridique servant une gouvernance consensuelle, à l’opposée de la gestion autoritaire. Il faut noter une véritable « ascension » du contrat comme mode d’action publique82 , au dépend de l’acte unilatéral, qui demeure malgré tout, en principe, le mode d’action de l’Administration83 . Le contexte politique et économique a en effet poussé l’Etat à mettre de côté le dirigisme centralisateur qui le caractérisait, au profit de la négociation. De même, la décentralisation et la pénétration du droit anglo-saxon au sein de notre système juridique ont contribué également à faire la part belle au contrat. Enfin la reconnaissance constitutionnelle de la liberté contractuelle des personnes publiques84 , a achevé de rénover la place de l’outil contractuel. En revanche, le recours au contrat pour subvenir aux besoins de l’administration est un domaine d’intervention « classique » du contrat, qui prend la forme d’un marché public dont la réglementation a été saisie par le droit de l’Union Européenne. Le contrat permet « d’inciter sans contraindre ». Cette façon « consensuelle et partenariale d’administrer »85 donne lieu à une action publique davantage horizontale, prenant à contre-pied la vision pyramidale attachée classiquement au secteur publique. Or 79 Librement inspiré de : F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une rencontre impossible ? », art. préc. 80 J. MORAND-DEVILLER, Droit administratif, coll. Cours, Montchrestien, 12e éd., 2011, p. 384. 81 Ibid. 82 Conseil d’Etat, Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Rapport public, EDCE n°59, La Doc. fr., 2008, p. 17. 83 Le caractère exécutoire des décisions administratives demeure en effet « la règle fondamentale du droit public » (CE, 2 juillet 1982, Huglo, req. nos 25288 et 25323). 84 Cons. const., 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, L. relative au secteur de l'énergie. 85 J. MORAND-DEVILLER, Droit administratif, Op. cit., p. 384.
- 33. 33 c’est précisément ce mode bureaucratique qui résiste au dogme de la performance et la fonction publique en est la parfaite illustration. Ainsi le « mode contractuel » devient-il à la « mode » et semble davantage propice à être regardé par le prisme de la performance. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si dans une optique de performance la nouvelle gestion des agents publics se tourne vers l’outil contractuel, comme lorsqu’il s’est agit de valoriser économiquement des ressources publiques telles que le domaine public ou privé. Le contrat est l’instrument de l’efficacité. Le succès du contrat témoigne donc de son efficacité. Le contrat va de paire avec une « vision stratégique ». C’est ce qui est exprimé en substance par la Vice-Président du Conseil d’Etat, dans son éditorial86 introduisant le rapport de 2008 précité. Pour lui, grâce au contrat, la puissance publique exprime et hiérarchise ses besoins puis définis « les moyens les plus appropriés pour y parvenir ». Cette nouvelle stratégie doit permettre de répondre aux besoins du public avec souplesse, efficacité et au meilleur coût. Autrement dit, le contrat doit permettre la performance. Partant, qu’une politique publique peut être définie comme « un programme d’action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales. »87 , le contrat est au service de la réussite de celles-ci88 . Mais surtout, la modernisation de l’Etat et de ses services publics va souvent de paire avec l’utilisation du contrat89 . Afin de parvenir à une nouvelle gestion publique, une nouvelle façon de mettre en œuvre les politiques publiques est élaborée. Les contrats de performance furent alors mis en place dans les années 9090 . La forme contractuelle est donc préconisée91 au côté de d’autres outils pour rénover la gestion publique. Le contrat, comme support de l’échange marchand. C’est la fonction la plus ancienne de l’Administration92 . Encore aujourd’hui, les achats des personnes publiques 86 J.-M. SAUVÉ, « Pour un développement maîtrisé du contrat », Éditorial, in Conseil d’Etat, Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Rapport public, op. cit., p. 8. 87 J.-C. THOENIG, « L’analyse des politiques publiques », in Traité de science politique, J. LECA et M. GRAWITZ (dir.), PUF, 1985. 88 V. en ce sens : M. KARPENSCHIF, « Le contrat au service des politiques publiques : Contrat public et Union européenne », RFDA 2014, p. 418. 89 C. POLLITT, G. BOUCKAERT, Public Management Reform. A comparative analysis, Oxford University Press, 2000. 90 Circ. 23 février 1989 relative au renouveau du service public. 91 V. en ce sens : R. FAUROUX, B. SPITZ, État d’urgence, réformer ou abdiquer : le choix français, Robert Laffont, 2005. 92 Déc. 10 brumaire an IV
- 34. 34 régissent la vie quotidienne des administrations et leur permettent de se donner les moyens de leur action. Or le contrat permet de « mobiliser les savoir-faire et les financements qui font défauts à la puissance publique »93 . Aussi il est évident que pour subvenir aux besoins de l’Administration, le mode contractuel est aussi bien inévitable, qu’essentiel. Cette place prépondérante fait des marchés publics, un enjeu majeur de l’action publique. L’efficacité de la contractualisation en vue d’un achat. Malgré son utilité naturelle pour une gestion performante de l’Administration, cet outil contractuel doit encore être « maîtrisé »94 , selon les termes du Vice-Président du Conseil d’Etat. Ce dernier considère, d’une part, que ce procédé doit être utilisé à bon escient, par des agents publics sensibilisés à ce mode d’action. D’autre part, il faut l’encadrer par des règles afin qu’il soit conforme aux directives européennes. Or, si l’on se plie à ces vérifications, il apparaît que le contrat étant l’outil des échanges marchands, il est forcément utilisé à bon escient lorsqu’il est destiné à l’achat. De plus, la transposition récente des dernières directives européennes a permis une incorporation des règles de la commande publique européenne en droit français. Cependant, il désormais indispensable de s’intéresser à l’utilisation optimale du contrat par les agents publics. Autrement dit, une fois que l’on sait que le mode consensuel est le plus adapté à une action, il vient immédiatement la seconde problématique à savoir comment contracter efficacement, tant concernant la passation, la définition du contenu, l’exécution ou le contentieux contractuel. Ainsi le contrat, après avoir été l’outil d’accomplissement des politiques publiques, devient lui-même l’objet d’une politique publique. Les limites de l’utilisation du contrat suivent les frontières de la performance publique. La liberté contractuelle n’étant pas absolue, il existe des limites à cette contractualisation. Les domaines dits « régaliens » lui sont fermés, au même titre que la performance. Concernant les limites du contrat, le juge constitutionnel a posé une interdiction très nette de déléguer des missions de souveraineté à des personnes privées95 , même s’il semble de plus en plus conciliant96 . Le Conseil d’Etat quant à lui ne parle pas de mission de 93 Conseil d’Etat, Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Rapport public, op. cit. 94 J.-M. SAUVÉ, art. préc. 95 Cons. Const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, L. habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. 96 Cons. Const., 22 mars 2012, n° 2012-651 DC, L. de programmation relative à l'exécution des peines.
- 35. 35 souveraineté mais nous dit qu'il est interdit aux personnes publiques de contracter à propos de l'exercice du pouvoir de décision unilatérale97 . Enfin le contrat est interdit en matière de police administrative. Ainsi, il est notamment interdit d’exercer une mission de police au moyen du contrat98 . De la même façon, à propos cette fois-ci de la performance, Gil Desmoulin considère très justement que « la recherche de performance de certaines politiques publiques n'est pas une fin en soi notamment parce que les missions régaliennes ont une utilité qui va au-delà de l'utilité matérielle. En raison de leur dimension politique ou stratégique, elles ne peuvent pas être « sacrifiées » sur l'autel de la performance. En conséquence, il est parfois indispensable d'accepter la non-performance ou la contre-performance des politiques publiques. »99 L’utilisation du contrat et la mise en œuvre d’une gestion performante semblent donc avoir un périmètre d’action équivalent. Pour l’un, comme pour l’autre, cette limitation commune s’explique par leur nature. D’abord, comme la relation contractuelle crée des droits pour chaque partie, il semble inenvisageable de passer par le contrat pour une mission de police, puisque l’autorité de police verrait alors nécessairement ses prérogatives limitée, paralysant du même coup cette mission de service public100 . Ce même syllogisme peut être employé pour expliquer l’indispensable acceptation de la non-performance quant à certains services publics, puisque « le souci légitime d'efficience de l'administration ne doit pas conduire à l'abandon ou à la paralysie de l'action administrative. »101 Le contrat, comme la performance, sont ainsi deux notions, l’une juridique et l’autre économique qui sont interconnectées. Aussi contrat et performance peuvent à nouveau se rencontrer, cette fois plus spécifiquement au sein de la fonction achat de l’Administration. Cette collaboration entre personnes privées et publiques correspond en effet à une des relations que peut entretenir l’Administration avec le monde économique102 (B). 97 CE, 30 sept. 1983, Féd. départementale des associations agrées de pêche du Dépt. de l'Ain, nos 31875 et autres. 98 CE, 8 mars 1985, Association les amis de la Terre, n° 24557. 99 G. DESMOULIN, « La recherche de la performance des politiques publiques. De l'illusion à la raison ? », AJDA 2013, p. 894. 100 J. MOREAU « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat », AJDA 1965. 101 G. DESMOULIN, « La recherche de la performance des politiques publiques. De l'illusion à la raison ? », art. préc. 102 S. NICINSKI, Droit public des affaires, coll. Domat, LGDJ, 4e éd., 2014, p. 507.
- 36. 36 B. L’achat public : un acte économique saisie par l’exigence de performance L’achat public, un acte économique régit par le droit public de l’économie. L’économie recouvre aussi bien les activités de production, de distribution, que de consommation des richesses. L’achat public se rapportant au volet « consommation » de l’économie, l’achat est un acte économique. L’Administration intervient donc à ce titre sur le marché. Les pouvoirs adjudicateurs vont donc être autant soumis à la libre concurrence au même titre que n’importe quel autre opérateur économique. Cependant, le droit de l’Union Européenne a toujours considéré que les acheteurs publics n’avaient pas un comportement normal sur un marché, c’est à dire que dans certains cas ils pouvaient être guidés par des choix non-économiques. La crainte de l’Union Européenne est que les Etats membres favorisent leurs entreprises nationales. C’est notamment pour cette raison que le droit administratif français a été « saisi par la concurrence »103 . Paradoxalement, ces procédures de mise en concurrence et de publicité signifient aussi que l’Etat « choisit de réduire son altérité et de se penser dans les formes communes de l'entreprise. »104 Le lien entre l’Etat et l’économie s’en trouve restauré. A l’austérité vis-à-vis du marché et de sa « logique dégradante »105 va succéder une logique partenaire entre le droit et l’économie, à tel point que l’Etat va se voir contraint de se réaliser « lui aussi, sur le terrain de l’économie. »106 La nature économique de l’achat suppose une lecture performancielle des procédures qui s’y rattachent. « Si les indicateurs financiers sont essentiels dans un cadre privé, ce n'est pas le cas pour le secteur public. Sauf dans l'hypothèse d'activités industrielles et commerciales »107 Or les marchés publics sont précisément le support d’une activité commerciale des personnes publiques. Il apparaîtrait donc logique qu’en matière d’achat, l’exorbitance laisse place à la performance. Cette nouvelle conception juridique s’inscrit au sein du droit public de l’économie qui correspond à « la partie du droit public (qui régit l’action des personnes publiques), qui 103 J. CAILLOSSE, « Le droit administratif français saisi par la concurrence ? », AJDA 2000, p.99. 104 Ibid. 105 Ibid. 106 Ibid. 107 G. DESMOULIN, « La recherche de la performance des politiques publiques. De l'illusion à la raison ? », art. préc.
- 37. 37 porte sur le domaine de l’économie »108 . Ce droit depuis 1945 s’est en effet structuré autour de plusieurs thèmes, au nombre desquels on trouve évidemment les contrats de la commande publique109 . Or ce droit économique, tout public soit-il, a ceci de précieux qu’il emprunte aux différentes branches du droit. Cette approche globale du droit public économique est revendiquée110 , de telle sorte que la distinction traditionnelle entre droit privé et droit public ne fait alors plus sens. Il s’agit donc « du triomphe d’une troisième voie »111 car ce droit doit par essence régir les relations entre l’Administration et les opérateurs économiques112 . Finalement c’est à ce droit public de l’économie qu’il revient d’évoluer et de faciliter l’incorporation des méthodes du secteur privé. La logique de performance devrait donc pouvoir être prise en compte par le droit des marchés publics. La prise en compte par le droit des marchés publics d’une logique de performance. « La rationalité managériale a pénétré dans l'administration, non pas en marge ou à côté du droit, mais en empruntant le canal juridique »113 , révolutionnant de facto « la constitution juridique de l’Administration » 114 . Ainsi l’instrument ayant permis l’avènement d’un service public performant a bien été le droit. Le droit administratif économique a donc bien sûr était remanié pour prendre en compte cette nouvelle exigence. Dans une optique d’optimisation des ressources utilisées par les administrations afin d’accomplir un service public de qualité, des réformes successives du Code des marchés publics ont permis d'assouplir les règles de passation. La compatibilité de l’achat public avec une vision performante est désormais affirmée. De plus, la technique d’incorporation de cette exigence économique de performance est à présent connue : ce sera le droit public économique. Or l’adéquation de ce droit avec l’exigence de performance semble bien meilleure, puisque il s’agit d’un droit commun, qui n’est normalement en rien exorbitant, comme on avait pu le dire pour le droit administratif. L’exorbitance du droit de l’achat public, un nouveau combat pour la notion de performance. Malgré le fait que les marchés publics soient des contrats qui de par leur objet 108 P. DEVOLVE, Droit public de l’économie, Dalloz, 1998, p.1. 109 S. BRACONNIER, Droit public de l’économie, coll. Thémis Droit, PUF, 2015. 110 D. LINOTTE, R. ROMI, Droit public économique, 7e éd., LexisNexis, coll. Manuel, 2012, p. 11. 111 Ibid., p. 12. 112 S. NICINSKI, Droit public des affaires, op. cit., p. 9. 113 J. CHEVALLIER, « Le droit administratif vu de la science administrative », AJDA 2013, p.401. 114 J. CAILLOSSE, La constitution imaginaire de l'administration, coll. Les voies du droit, PUF, 2008.
- 38. 38 sont des contrats administratifs identiques à ceux de droit privé. Ceci a pu être affirmé avec beaucoup de force par le passé115 . Pourtant ce secteur est « un des secteurs où la spécificité du droit public s’est affirmé le plus clairement. » 116 L’achat public performant, en passant par le droit public économique, évite ainsi l’exorbitance originelle et contre performante du droit administratif. Cependant, il reste à accomplir une difficile et paradoxale conciliation de l’efficacité de l’achat public, avec les règles spécifiques applicables aux pouvoirs adjudicateurs et fondées sur la libre concurrence. Il faut ainsi faire face à une nouvelle forme d’exorbitance puisque seules les personnes publiques se voient contraintes dans leur comportement pour parvenir à une action en conformité avec une concurrence qui doit paradoxalement être libre. Cette exorbitance est certes un obstacle moindre que celle du droit administratif, puisque le droit public économique ne se définit pas à travers elle, pour autant la constitution juridique de l’achat public attend encore d’être révolutionnée et c’est tout l’enjeu de cette étude que de donner les clés pour parvenir à une pleine et entière correspondance entre l’exigence de libre concurrence et celle de performance, lorsqu’elles sont toutes deux appliquées aux personnes publiques. Ce premier enjeu qu’il faut prendre en compte afin de définir une obligation de performance n’est pas le seul. Il est également indispensable de relever que la seconde difficulté pour garantir une performance de l’achat public, est la globalisation à laquelle obéit désormais cette dernière. Puisque loin d’avoir pour unique objectif de permettre un achat public efficace, cette performance se voit confier de multiples objets (section 2). 115 F. LLORENS, Contrat d’entreprise et marché de travaux publics, LGDJ, 1981. 116 L. RICHER, Droit des contrats administratifs, Op. cit., p. 311.
- 39. 39 Section 2. Une performance globale Plan. Il faut garder à l’esprit, que la consommation est un moyen d’action puissant, surtout lorsqu’elle représente un marché de près de 200 milliards d’euros, soit environ 10% du PIB117 . La commande publique est donc devenue progressivement un outil au service de politiques publiques. Lorsque l’on se place dans le cadre du développement durable, l’efficacité économique de l’achat public prend une dimension globale. L’efficacité économique vise, en effet, « à produire des biens de consommation et à répartir les richesses de cette production de manière équitable, durable, avec le souci de la protection de l'environnement et du renouvellement des ressources consommées ainsi que de la protection des hommes et des femmes qui y travaillent. »118 . Néanmoins cette diversification des objectifs de performance ne doit pas faire perdre de vue la recherche d’efficacité et d’efficience en terme de « coûts » pour la commande publique. Le risque est en effet de faire passer au second plan ce qui est pourtant l’objectif premier des contrats de la commande publique, à savoir répondre de manière performante aux besoins des personnes publiques. Une politique d’achat responsable s’est belle et bien mise en place, apportant un gain de performance global bénéfique au développement durable (I). Néanmoins il est tout autant nécessaire que les bénéfices de cette responsabilisation de l’achat public puissent profiter à l’acte d’achat en lui-même (II). I. L’achat responsable au service d’une performance globale Plan. L’intégration des préoccupations de développement durable dans le droit de la commande publique (A), a fait naître l’achat responsable des personnes publiques (B). 117 Selon l’INSEE, pour les achats des administrations publiques uniquement, in Sénat, « Mission commune d’information sur la commande publique », Rapport d’information n°82, M. BOURQUIN (dir.), 14 octobre 2015, p. 30. 118 http://www.vedura.fr/economie.
- 40. 40 A. La prise en compte du développement durable par les marchés publics Marchés publics et développement durable. Le développement durable peut se définir comme un développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »119 . Cet objectif fut entériné lors de l’établissement de « l’Agenda 21 » au sommet de Rio en 1992. Le développement durable possède trois composantes qui doivent être conciliées : croissance économique, équité sociale et respect de l’environnement. Cet objectif doit par ailleurs être rempli par l’ensemble des acteurs économiques, qu’ils soient privés ou publics120 . « Les agendas 21 » ont d’ailleurs entérinés cette nouvelle obligation à l’échelon national121 . Dès lors, la prise en compte de cet objectif de développement durable apparaissait inéluctable pour la commande publique. En particulier au regard du poids économique de cette dernière. Code des marchés publics de 2001. L’intégration de l’objectif de développement durable dans le droit de la commande publique a néanmoins été difficile, en raison de la résistance aussi bien du gouvernement, que des juges. La rédaction du Code des marchés publics de 2001 a en effet laissé peu de place à la prise en compte de telles exigences. Seules les conditions d’exécution des marchés prévoyaient la possibilité de fixer, dans les cahiers des charges, des conditions relatives à la promotion de l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à la lutte contre le chômage ou à la protection de l'environnement122 . Une limite était par ailleurs prévue puisque ces considérations environnementales et sociales ne devaient pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats. Au niveau des critères de choix de l’offre, aucune référence expresse au développement durable n’existait123 . Il était donc laissé au juge le soin de déterminer si ces critères sociaux ou environnementaux étaient les bienvenues. Or selon le Conseil d'État il était possible pour les pouvoirs adjudicateurs, même sous l’empire du Code de 2001, de 119 « Notre avenir à tous », Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, G. H. BRUNDTLAND (prés.), 1987. 120 Suite, plus précisément, à la Charte d’Aalborg en 1994 qui concernait plus largement l’ensemble des collectivités de l’Union Européenne : Chapitre 4 § 23 de l’agenda 21. 121 L. n° 95-115. 4 févr. 1995 relative à l'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, art. 25 II. 122 CMP 2001, art. 14. 123 CMP 2001, art. 53 II.
- 41. 41 choisir des critères d’attribution du marché qui n’étaient pas énumérés par le code ou de prévoir des clauses d’exécution prenant en compte les exigences de développement durable, à condition que celles-ci soient en lien avec l’objet du marché124 . Cependant, le juge adopta une approche restrictive de ce lien125 . L’insistance internationale. Une prise en compte variable des objectifs de développement durable uniquement au niveau des conditions d’exécution, plutôt qu’au stade de la sélection et donc de la passation des marchés publics semblait absurde, voire même « byzantin »126 pour certains. « L'introduction de tels critères dans les cahiers des charges (pouvait) se révéler tout aussi discriminatoire que de les faire figurer au stade de l'offre. »127 Le respect du cahier des charges étant bien sûr pris en considération lors de la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse. Aussi le Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, aboutit à encourager « les autorités compétentes à tous les niveaux à prendre en compte le développement durable lors de la prise de décisions ayant trait notamment (...) à la passation des marchés publics. »128 C’est donc bien à la « passation » qu’il était fait référence, ce qui annonçait des évolutions. L’encouragement européen d’un achat public durable. L’union européenne abonda dans ce sens. C’est d’ailleurs par l’intermédiaire de deux communications interprétatives que la Commission européenne expliqua les possibilités données aux acheteurs publics et encouragea de telles initiatives favorables au développement durable129 . Toutefois, ces critères doivent toujours cumulativement se rapporter à l’objet du marché et apporter un avantage économique direct aux pouvoirs adjudicateurs. De même, la jurisprudence de la Cour de justice a accepté de reconnaître un critère de « mieux-disant social» en 1988, dans une affaire «Beentjes»130 , pour ensuite consacrer 124 CE, 25 juillet 2001, Cne de Gravelines, n°229666. 125 Voir en ce sens : CE, 10 mai 1996, Féd. nat. des travaux publics et a., n° 159979 ; TA Strasbourg, 30 nov. 1999, Préfet région Alsace, préfet Bas-Rhin c/ communauté urbaine Strasbourg, Sté Am Port'llnes. 126 O. SCHMITT, « La commande publique et le développement durable », La Gazette du Palais, n°168, 2005, pp. 4-19. 127 Ibid. 128 « Rapport du sommet mondial pour le développement durable », Nations Unies, 2002, A/Conf.199/20 129 CE, comm. sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations environnementales dans lesdits marchés (4 juillet 2001, COM(2001)-274 final) ; CE, comm. sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés (15 octobre 2001, COM(2001)-566 final). 130 CJCE, 20 sept. 1988, aff. 31/87, Gebroeders Beentjes BV c/ État des Pays-Bas, Rec. CJCE p. 4635.
- 42. 42 pleinement la prise en compte de critères sociaux dans les marchés publics, même à l’occasion de l’analyse de l'offres, à condition de respecter les principes fondamentaux et notamment le principe de non-discrimination131 . Ainsi en n’exigeant pas que le critère social procure un avantage économique pour le pouvoir adjudicateur, la CJCE apparaît plus souple que les communications de la Commission. Par la suite et en adoptant le même raisonnement, ce fut au tour du critère environnemental d’être abondé par la Cour de justice132 . C’est d’ailleurs sans doute inspirée par cette « ouverture » jurisprudentielle, vis-à-vis de telles considérations, qu’une nouvelle directive intégrant cette possibilité de prendre en compte le développement durable dans la commande publique a vu le jour en 2004133 . Néanmoins, elle conserve une certaine « ambigüité »134 vis à vis des critères environnementaux et sociaux, en manquant de clarté quant aux limites de leur emploi135 . La charte de l’environnement. Ces évolutions ont été suivies de près par une progression de la norme constitutionnelle. L’article 6 de la Charte de l’environnement qui naît en 2004, dispose que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social »136 . Dès lors, au plus haut niveau de l’ordre normatif français, le Code des marchés publics devient un outil au service d’une politique de développement durable. Développement durable et sélection des offres : l’apparition des critères sociaux et environnementaux. La prise en compte de considérations environnementales dans les critères de sélection des offres fut finalement permise par le nouveau code de 2004. La protection de l'environnement fait donc expressément son entrée au nombre des critères à prendre en compte lors de l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse137 . 131 CJCE, 2 septembre 2000, Commission c/ France, aff. C-225/98, BJCP no 14, p. 13. 132 CJCE, Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab, et Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne, aff. C-513/99, BJCP no 26, p. 14. 133 Dir. 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 134 N. BOULOUIS, « Le contrat public au service des politiques de développement durable : limites et perspectives », RFDA 2014, p. 617. 135 Ibid. Consid. n° 1 136 L. const. n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement . 137 CMP 2004, Art. 53.
- 43. 43 Ce n’est qu’en 2005138 , que l’article 53 va plus spécifiquement accueillir le critère des « performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté. » La jurisprudence tant européenne139 que française140 a appuyé cette évolution. Ainsi l’utilisation d’un critère social ou environnemental au stade de l’analyse des offres est possible mais demeure conditionnée. Il doit effectivement y avoir, d’une part, un lien entre l'objet du marché et le critère ou la clause dite « durable », et d’autre part, la clause ou le critère ne doivent pas être discriminatoires, c’est à dire qu’aucune entreprise ne doit être favorisée, indépendamment de son offre. Ces exigences sont néanmoins interprétées de plus en plus largement. Ainsi l’achat public s’est mué en véritable outil au service des politiques publiques de développement durable. Le Code de 2006 et l’institutionnalisation de la commande publique durable. C’est finalement en 2006 que les exigences liées au développement durable furent incluses à la définition des besoins141 , à la sélection des candidatures142 , ainsi qu’aux spécifications techniques143 , comme ce que préconisait déjà la directive de 2004 précitée144 . Par ailleurs, non plus juridiquement, mais administrativement de nombreuse structures ont vu le jour pour encourager puis accompagner l’apparition de ces nouveaux objectifs. Lorsque l’achat public se structure, c’est autour de cette notion de développement durable. On pense notamment, dès 2003 à la Stratégie nationale de développement durable (SNDD)145 , puis à la nouvelle Stratégie nationale de développement durable pour la période 2010-2013 (SNDD)146 qui ont eu pour objet de concourir à une diminution de l’impact environnemental du fonctionnement de l’Administration. Le Groupement d'étude des marchés développement durable, environnement a aussi été créé147 , tout comme, ensuite l'Observatoire économique de l'achat public148 . Plusieurs circulaires149 , ainsi qu’un « Plan 138 L. n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale. 139 CJUE, 10 mai 2012, aff. C-368/10. 140 CE, 25 mars 2013, Département de l'Isère, n° 364950. 141 Code des marchés publics de 2006, art. 5. 142 Ibid., art. 45. 143 Ibid., art. 6. 144 Ibid. Consid. n° 29 et Art. 23. 145 Adoptée le 3 juin 2003 par le Comité interministériel du développement durable (CIDD). 146 Adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité interministériel pour le développement durable (CIDD). 147 JO 28 Janvier 2004. 148 En application de l'article 136 du Code des marchés publics, JO 13 novembre 2005. 149 Circ. 5 avr. 2005, sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des forêts ; Circ. 28 sept. 2005, sur le rôle exemplaire de l'État en matière
- 44. 44 national d'action pour des achats publics durables »150 ont également poussé les services de l’Etat à plus de responsabilité dans leurs achats. La Révision générale des politiques publiques (RGPP) démarrée en 2007 et qui a été remplacé en 2012 par la Modernisation de l’action publique (MAP) ont toutes les deux mis en avant ces nouveaux objectifs151 . Finalement, le Service des achats de l'État (SAE) a vu le jour en 2009152 et a été remplacé dernièrement par la Direction des achats de l’Etat (DAE) qui doit notamment veiller à ce que « les achats de l'État (…) respectent les objectifs de développement durable »153 La commande publique au service de politiques publiques. Les nouvelles directives de 2014154 , ont marqué une nouvelle étape dans ce processus155 . Les trois directives illustrent avec une même intensité l’importance qu’attache le législateur européen pour ces nouveaux objectifs. La directive relative à la passation des marchés publics donne la possibilité aux Etats membres de réserver certains lots ou marchés à des entreprises ayant un objet social156 . De même, un « verdissement de la commande publique » est clairement constaté157 . La commande publique, de part son poids économique est donc bien devenue un levier au service de politiques publiques comme l’insertion professionnelle ou la protection de l’environnement. Le développement durable devient « l’objectif secondaire » 158 du droit de la commande publique, à côté du principal objectif de celle-ci qui est de répondre utilement aux besoins des personnes publiques. Guillaume Cantillon explique cette transformation du droit des marchés publics par la rencontre de deux objectifs différents que les administrations d'économies d'énergie ; Circ. 2 mai 2008, relative à l'exemplarité de l'État en matière d'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective. 150 Adopté le 13 novembre 2006 par le Comité interministériel du développement durable (CIDD). 151 G. CANTILLON : « Marchés publics et développement durable », Fasc. 57, Jurisclasseur, LexisNexis. 152 D. n° 2009-300, 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'État, art. 2. 153 D. n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat. 154 Dir. 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ; Dir. 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; Dir. 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. 155 P. THIEFFRY, « Le verdissement de la commande publique, acte II : prise en compte de l'analyse du cycle de vie et des procédés et méthodes de production » RTD Eur. 2015 p.470. 156 Dir. 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Consid. 36 157 P. THIEFFRY, « Le verdissement de la commande publique, acte II : prise en compte de l'analyse du cycle de vie et des procédés et méthodes de production », art. préc. 158 M. KARPENSCHIF, « Le contrat au service des politiques publiques : “Contrat public et Union européenne“ », RFDA 2014, p.418.
- 45. 45 doivent poursuivre : la recherche d’efficience et d’efficacité de l’achat public, ainsi que la poursuite du bien public159 (B). B. Le prérequis nécessaire à la performance de l’achat public : l’achat responsable Définition des achats responsables. L’achat responsable sert la performance globale. Il se définit comme « Tout achat intégrant dans un esprit d’équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement économique. L'acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de la qualité des prestations et l’optimisation des coûts globaux (immédiats et différés) au sein d’une chaîne de valeur et en mesure l'impact. »160 Ainsi l’impact environnemental de l’achat doit être le moins élevé possible, tandis que les répercussions sociales doivent, quant à elles, être les meilleures possibles. Dans le même temps, un objectif de performance des finances publiques doit être poursuivi afin de d’acheter au meilleur coût. Source : ObsAR L’origine de l’achat responsable : la RSE. L’achat responsable trouve certes son origine dans l’idée de développement durable, mais ce type d’achat est plus directement la suite logique des notions de Responsabilité sociale des entreprise (RSE) ou Responsabilité sociale des organisations (RSO). Il s’agit de deux concepts imaginés en réaction à la thèse néolibérale de Milton Friedman, prix Nobel de l’économie, qui en 1970, dans les pages du New York Times utilisait déjà le terme de responsabilité sociale de l’entreprise à un tout autre dessein. En effet, il considérait cette responsabilité comme se résumant à la recherche du plus grand profit, « la 159 G. CANTILLON, « Création du “Service des achats de l'État“ : vers un achat public performant et durable ? », Contrats et Marchés publics n° 5, 2009. 160 Définition de l’Observatoire des Achats Responsables, 2011.
- 46. 46 main invisible »161 décrite par Adam Smith permettant à l’intérêt général de s’élever par voie de conséquence, dès lors que la libre concurrence était respectée162 . Plus précisément la RSE, à proprement parler naît de la théorie des « Stakeholders »163 , qui apparaît aux Etats-Unis dès les années 60. Selon cette théorie, maximiser les profits pour une entreprise n’est pas suffisant. Il est nécessaire de trouver le compromis équitable entre les intérêts de l’ensemble des personnes qui sont de près ou de loin rattachés à l’entreprise : employés, clients, gouvernés, gouvernants, collectivités, etc. L’entreprise s’engage alors sur certaines pratiques et accepte d’en rendre compte, d’où une certaine responsabilisation qui a été consacrée en droit français par la loi NRE de 2001164 . L’évolution de la RSE : la performance globale. Le concept de performance globale a émergé, en 2002 avec l’association du « Centre des jeunes dirigeants d’entreprises » (CJDE). La performance globale a alors pu être définie comme « la prise en compte d’un équilibre entre performance économique, sociale, sociétale et environnementale »165 . Cette performance est une exigence pour les entreprises productrices qui pourrait être appliquée aux acheteurs publics consommateurs. Elle reposerait sur quatre dimensions complémentaires : - performance sociale : elle repose sur la capacité du pouvoir adjudicateur à encourager les opérateurs économiques à rendre les hommes acteurs et auteurs ; - performance sociétale : elle s’appuie sur la contribution de l’opérateur économique au développement de son environnement ; - performance économique : elle honore la confiance des opérateurs économiques et des usagers et se mesure par des indicateurs ; - performance environnementale : elle repose sur la capacité du pouvoir adjudicateur à encourager les opérateurs économiques à mettre en place des mesures de protection de l’environnement. La différence avec la RSE réside dans le fait que la performance globale prend en compte les besoins et les réalités de l’organisme en question, alors que la RSE et le développement 161 A. SMITH, La richesse des nations, Gf-Flammarion, t. 1, 1999. 162 Cité par : Centre des jeunes dirigeants d’entreprises, Guide de la performance globale, éd. des organisations, 2004. 163 Littéralement : « ceux qui ont un intérêt dans l’entreprise », ce sont les parties prenantes, par opposition au « shareholders » qui sont les actionnaires. 164 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 165 CJDE, Guide de la performance globale, éd. des organisations, 2004, p. 5
- 47. 47 durable, ne sont en effet pas centrés sur l’entreprise ou la collectivité, mais bien sur l’environnement, au sens large. Il semble donc que la performance globale soit une notion directrice mieux adaptée aux acheteurs publics. Cependant, il s’agit encore d’une notion vague de « performance », joint au qualificatif tout aussi abstrait de « globale » 166 . Le CJDE se sert de la commande publique pour encourager cette performance globale des entreprises, dans le cadre du développement durable167 . Au départ cette notion n’est donc pas censée profiter en premier lieu à l’Administration. L’utilité de la performance globale pour l’Administration. Un achat public performant globalement nécessite un achat public responsable. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’orienter leur politique d’achat vers des achats responsables pour plusieurs raisons. D’une part, la réglementation et les initiatives internationales ou nationales peuvent l’encourager, voire le rendre obligatoire168 . D’autre part, les achats dits responsables sont facteurs de stabilité et d’exemplarité pour les administrations. Cet atout en terme d’image, correspond à un gain politique, à court terme. Les usagers des services publics attendent cette exemplarité de l’Administration. Il vient par ailleurs s’ajouter, à moyen et long terme, des gains financiers, parfois difficilement quantifiable. L’Administration peut en effet entrer dans une démarche novatrice visant à réduire les coûts énergétiques, à valoriser l’écosystème du pouvoir adjudicateur et des opérateurs économiques. Ainsi l’administration pourra également tirer un profit économique d’une démarche encourageant la performance globale. Pour autant, afin que le pouvoir adjudicateur tire effectivement et directement profit de ses achats responsables, il est absolument nécessaire de bien définir dans quelles mesures l’achat public encourage une production conforme aux principes de développement durable. L’achat de l’Administration heurte le prisme de l’intérêt général et se disperse en une multitude d’exigences extrinsèques toute plus éloignées de la fonction de l’achat purement intrinsèque à l’origine. Ainsi, à l’image de la lumière rencontrant le prisme, c’est un spectre qui risque d’apparaître, troublant la vision performancielle que doit avoir l’Administration lorsqu’elle subvient à ses besoins (II). 166 V. en ce sens : Y. PESQUEUX, « La notion de performance globale », Forum international ETHICS, 2004. 167 V. Rapport du CJDE et de Communauté urbaine de Nantes, « Vers la performance globale de la commande publique », 2011. 168 V. supra.
- 48. 48 II. La mise en œuvre performante de l’achat responsable Plan. Pour que la performance globale d’abord et la performance de l’achat public ensuite soient effectives, il est nécessaire de concilier l’ensemble des objectifs de développement durable entre eux. Pour cela l’achat public doit être équitable (A) et ne doit pas être instrumentalisé (B). A. L’achat public durable et performant : le choix de l’équité Le commerce équitable. Le commerce équitable tout en étant respectueux des enjeux économiques, demeure socialement respectueux. Il lui a même été donné des vertus environnementales, puisque la Commission européenne a pu considérer qu’il avait « pour finalité de contribuer à l'établissement des conditions propres à élever le niveau de la protection sociale et environnementale dans les pays en développement »169 . Ce type d’achat est au service du développement durable, comme le prouve la communication de la commission au Conseil et au Parlement Européens, ainsi qu’au Comité économique et social européen, intitulée « Contribuer au développement durable : le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d'assurance de la durabilité liés au commerce. »170 De même, on peut lire dans une loi de 2005 que « le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. »171 . Par conséquent, on remarque que l’achat public équitable serait un procédé ayant essentiellement des conséquences extérieures à l’Administration. Pourtant, elle doit aussi pouvoir en profiter en interne, autrement la performance globale ne pourrait jamais être pleinement accomplie, puisque la performance de l’achat public s’inscrit au sein de la composante économique de la performance globale172 169 Doc. COM, 29 nov. 1999, 619 final (non publiée au JOCE), in G. CANTILLON in Achat public équitable, concurrence pour le marché et concurrence dans le marché, Contrats et Marchés publics n° 2, Février 2011, étude 2. 170 COM (2009) 215, 5 mai 2009. 171 L. n° 2005-882, 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, art. 60. 172 V. supra.