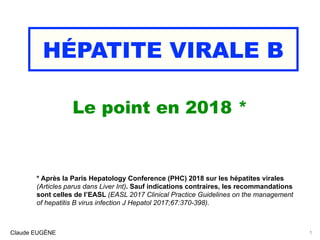
HEPATITE VIRALE B : LE POINT EN 2018
- 1. HÉPATITE VIRALE B Le point en 2018 * Claude EUGÈNE * Après la Paris Hepatology Conference (PHC) 2018 sur les hépatites virales (Articles parus dans Liver Int). Sauf indications contraires, les recommandations sont celles de l’EASL (EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection J Hepatol 2017;67:370-398). 1
- 2. HÉPATITE VIRALE B Une infection fréquente 1) 257 millions de personnes Potentiellement grave 900 000 morts par an ………………………………………….………………………………………………….. 1) En diminution grâce à la vaccination et aux progrès de l’hygiène Claude EUGÈNE 2
- 3. HÉPATITE VIRALE B Une vaccination efficace Et sûre Des analogues puissants Mais nécessitant habituellement un traitement prolongé Claude EUGÈNE 3
- 4. HÉPATITE VIRALE B Définir infection et hépatite Infection Présence du virus : ADN viral B = + Hépatite Lésions hépatiques induites par la réaction immunitaire Claude EUGÈNE 4
- 5. HÉPATITE VIRALE B Deux formes Hépatite aiguë Rarement fulminante 1) Hépatite chronique Virus B > 6 mois ………………………………………………………….……… 1) 1 à 5% des malades (à évaluer en vue d’une transplantation du foie) Claude EUGÈNE 5
- 6. HÉPATITE VIRALE B Histoire naturelle (1/3) Faire la part entre infection et « hépatite » Tous les sujets porteurs du VHB n’ont pas d’ hépatite (au plan histologique) Processus dynamique Interactions entre le virus de l’hépatite B (VHB) et la réponse immunitaire (qui crée l’hépatite) Deux grandes parties évolutives: Ag HBe (+) avec d’abord une période d’immuno-tolérance (qui peut durer des décennies, en particulier si contamination néo-natale), puis une phase active sous l’effet de la réponse immunologique (ALAT augmentées, baisse de l’ADN) et séro-conversion HBe (+) => HBe (-) et anti-HBe (+). Ag HBe (-) qui correspond soit à un portage inactif (ALAT toujours normales, ADN < 2000 UI/ ml, Ag HBs > 1000 UI/ml, soit à une hépatite chronique Ag HBe (-) en rapport avec un virus mutant (virus mutant pré-C) qui s’accompagne d’ALAT et d’ADN fluctuant dans le temps. Cette forme d’hépatite expose à la fibrose, la cirrhose et le carcinome hépato-cellulaire. Claude EUGÈNE 6
- 7. HÉPATITE VIRALE B Histoire naturelle (2/4) Faire la part entre infection et « hépatite » Tous les sujets porteurs du VHB n’ont pas d’hépatite (au plan histologique) Processus dynamique Interactions entre le virus de l’hépatite B (VHB) et la réponse immunitaire (qui crée l’hépatite) Evolution divisée en 5 phases Prenant en compte : Ag HBe, ADN viral B et ALAT 1) +/- une éventuelle inflammation du foie (hépatite) Schématiquement, on observe successivement : - IgM anti-HBc => IgG anti-HBc (qui persistera) - séroconversion Ag HBe => anti-HBe (qui persistera) - séroconversion Ag HBs => anti-HBs (qui persistera) ………………………….…………………………………………………………………………….…………… 1) Ces marqueurs doivent être répétés, malgré cela il n’est pas toujours facile de classer les cas Claude EUGÈNE 7
- 8. HÉPATITE VIRALE B Histoire naturelle (3/4) (Voir aussi tableau suivant) Phase 1 (Ag HBe +) (« tolérance immune ») ADN élevé, ALAT = N) Phase 2 (Ag HBe +) (« hépatite HBe + ») ALAT élevées Phase 3 (Ag HBe -) (« portage inactif ») Portage inactif => typiquement : Ag HBs < 1000 UI/mL ALAT = N; ADN normal ou bas Perte de l’Ag HBs (ou séroconversion HBs) : 1 à 3% / an Phase 4 (Ag HBe -) (« hépatite chronique Ag HBe-) Ag HBe (-), anti-HBe (+) ADN et ALAT fluctuent Peu de rémission spontanée Phase 5 Ag HBs (-) (anti-HBc +) ADN généralement indétectable Claude EUGÈNE 8
- 9. HÉPATITE VIRALE B Claude EUGÈNE 9 Histoire naturelle (4/4) Phases ALAT 1) ADN 2) Histologie 1 HBe(+) 3) « tolérance immune ») 4 N (< 40 UI/L) +++ nécrose, inflammation,fibrose: 0/+ 2 HBe (+) 4) (activité, séroconversion) ++ nécro-inflammation +/++ fibrose ++ 3 HBe (-) 5) (« porteur inactif ») Anti-HBe (+) N (- ) ou < 2000 UI/ml 6) risque faible de cirrhose parfois => hépatite chronique 4 HBe (-) Hépatite chronique HBe (-) Anti-HBe (+) N ou +/- nécro-inflammation fibrose 5 HBe (-) HBs Ag (-) anti-HBc (+) N -/+ Voir note 7) bas de page 1) ALAT = Alanine aminotransferase (appelée auparavant SGPT) 2) ADN viral B 3) Ag HBe 4) Phase plus fréquente et prolongée en cas d’infection péri-natale 5) Peut apparaître après plusieurs années de phase 2. Plus fréquente et de survenue plus rapide en cas de contagion à l’âge adulte. Evolution variable : soit (le plus souvent) séroconversion HBe , suppression virale (ADN -) et entrée dans la phase d’infection HBe (-), soit absence de contrôle du VHB et entrée dans une phase (longue) d’hépatite chronique HBe (-). 6) Parfois > 2000 mais < 20000 UI/mL, avec des ALAT = N de manière répétée (et lésions hépatiques minimes) 7) Perte Ag HBs avant la cirrhose, le risque de cirrhose, de décompensation et de carcinome hépatocellulaire (CHC) est faible. Si une cirrhose est présente, le risque de CHC persiste (échographie semestrielle)
- 10. HÉPATITE VIRALE B Chronicité : quels risques ? Fonction de l’âge de contamination Péri-natale => infection chronique : 90% des nouveau-nés Enfance => infection chronique : 20-40% Adulte => 0-10% Claude EUGÈNE 10
- 11. HÉPATITE VIRALE B Quels risques évolutifs ? Cirrhose à 5 ans : 8% à 20% Décompensation à 5 ans : 20% Carcinome hépatocellulaire (CHC) Risque annuel : 2 à 5% Claude EUGÈNE 11
- 12. HÉPATITE VIRALE B Carcinome hépatocellulaire (CHC) FACTEURS DE RISQUE A) L’hôte - Cirrhose - Nécro-inflammation - Sexe masculin - Age - Alcool, tabac - Co-infection (VIH, VHC 1) - Diabète - Antécédent familial de CHC - Origine africaine B) Facteurs viraux Taux élevés d’ADN viral et/ou d’AgHBs, génotype C > B, mutations ATTENTION ! Le risque peut persister après un traitement efficace (surtout si la maladie a évolué jusqu’au stade de cirrhose) ……………………………………………………………………..………………………………..………..…… 1) virus de l’immuno-déficience humaine, virus de l’hépatite C Claude EUGÈNE 12
- 13. HÉPATITE VIRALE B Et les génotypes ? (1/2) 1) NON ENCORE D’UTILISATION COURANTE (EMPLOYÉS DANS LES « STOPPING RULES » DE L’INTERFÉRON DÉFINITION A) Génotypes (A à J) Divergence de la séquence génomique entière > 7,5% Huit génotypes (G) (les G I et J sont sans doute des recombinaisons du G C) B) Sous-génotypes (# 40) Divergence de la séquence génomique entière > 4-7,5% VARIATIONS GEOGRAPHIQUES 2) Lien entre génotype et mode de transmission Asie : B et C, transmission verticale ++ Autres parties du monde : B et C <, transmission horizontale > 3) ……………………………………………………………………….…………………………..………………….……….…… 1) Réf. principale : Rajoriya N, Combet C, Zoulim F et al. How viral genetic variants and genotypes influence disease and treatment outcome of chronic hepatitis B. Time for an individualised approach ? J Hepatol 2017;67:1281-1297. 2) Génotype (G) A : Amérique du nord, Europe, Afrique du sud-est, Inde. G B et C : Asie, Océanie. G D (le plus répandu) : Amérique du nord, Afrique du nord, Europe, Moyen-Orient, Océanie. G E : Afrique de l’ouest. G F : Amérique du sud G G et H : Amérique centrale et du sud 3) Contact avec le sang ou le sperme (ou professionnelle) Claude EUGÈNE 13
- 14. HÉPATITE VIRALE B Et les génotypes ? (2/2) 1) NON ENCORE D’UTILISATION COURANTE INFLUENCE SUR Charge virale et pronostic Survenue du CHC 2) Réponse au traitement (interféron) …………………………………………………..……………………. 1) Réf. principale : Rajoriya N, Combet C, Zoulim F et al. How viral genetic variants and genotypes influence disease and treatment outcome of chronic hepatitis B. Time for an individualised approach ? J Hepatol 2017;67:1281-1297. 2) Carcinome hépatocellulaire Claude EUGÈNE 14
- 15. HÉPATITE VIRALE B Prise en charge du patient 1) Anamnèse - Antécédents personnels (Voyages, alcool,…) - Antécédents familiaux (Cirrhose ? cancer du foie ?) 2) Examen clinique - Angiomes stellaires ? Circulation collatérale ? - Hépatomégalie ? Splénomégalie ? … 3) Examens biologiques (cf plus bas) 4) Evaluer la fibrose (cf plus bas) Claude EUGÈNE 15
- 16. HÉPATITE VIRALE B Ne pas oublier la famille (1er degré) Et les partenaires sexuels Ag HBs, anti-HBc, anti-HBs Si absence de marqueurs vacciner Claude EUGÈNE 16
- 17. HÉPATITE VIRALE B Examens biologiques (1/2) Marqueurs viraux B - Ag HBs - Ag HBe, anti-HBe - ADN viral B Autres virus - sérologie Delta, VIH, VHC, VHA 1) Bilan hépatique Cf diapo suivante Marqueurs de fibrose 2) - Fibrotest *, Fibromètre* …………………………………………………………..………………. 1) Virus de l’immunodéficience humaine, virus hépatite C, virus hépatite A. 2) L’élastométrie impulsionnelle (Fibroscan*) est également intéressante. Le recours à la biopsie du foie reste nécessaire dans des cas sélectionnés Claude EUGÈNE 17
- 18. HÉPATITE VIRALE B Examens biologiques (2/2) Bilan hépatique ALAT 1), ASAT, GGT, PAL 2) bilirubine, albumine, gamma-globulines NFS-plaquettes, TP ………………………………………………..… 1) Alanine aminotransferase (transaminase, ex SGPT) 2) Phosphatases alcalines Claude EUGÈNE 18
- 19. HÉPATITE VIRALE B LES TRAITEMENTS Claude EUGÈNE 19
- 20. HÉPATITE VIRALE B Quels sont les buts du traitement ? (1/2) • Augmenter la survie et la qualité de la vie • Prévenir les manifestations extra-hépatiques • Prévenir la transmission de la mère à l’enfant • Eviter les réactivations (traitement immuno-suppresseur, chimiothérapie) Claude EUGÈNE 20
- 21. HÉPATITE VIRALE B Quels sont les buts du traitement ? (2/2) • Suppression à long terme de l’ADN viral B 1) • Normalisation des ALAT 2) • Perte de l’Ag HBe (si +), +/- séroconversion anti-HBe • Perte de l’Ag HBs, +/- séroconversion anti-HBs (but ultime, car il atteste d’une profonde suppression virale, mais rarement atteint) ………………………………………………………………….…………………… 1) La suppression de l’ADN viral B s’accompagne d’une amélioration clinique et histologique, d’une diminution de l’incidence de la cirrhose et du carcinome hépatotcellulaire. 2) Normalisation biochimique obtenue habituellement après une longue suppression de l’ADN viral B Claude EUGÈNE 21
- 22. HÉPATITE VIRALE B Réponse au traitement : comment la définir ? A) VIROLOGIQUE B) SEROLOGIQUE C) BIOCHIMIQUE D) HISTOLOGIQUE Claude EUGÈNE 22
- 23. HÉPATITE VIRALE B Réponse au traitement : comment la définir ? A) REPONSE VIROLOGIQUE a) Interféron pegylé Réponse ADN viral B < 2000 UI/ml à 6 mois et en fin de traitement Réponse soutenue ADN viral B < 2000 UI/ml > 12 mois après l’arrêt du traitement Claude EUGÈNE 23
- 24. HÉPATITE VIRALE B Réponse au traitement : comment la définir ? A) REPONSE VIROLOGIQUE b) Analogues Réponse ADN viral B indétectable (PCR sensible, < 10 UI/ml) Non réponse primaire (à 3 mois) Baisse < 1 log10 Réponse partielle Baisse > 1 log10 mais détectable à > 1 an de traitement Echappement Augmentation > 1 log10 par rapport au nadir 1) Réponse soutenue après l’arrêt ADN viral B < 2000 UI/ml > 12 mois après l’arrêt du traitement ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….… 1) Valeur la plus basse obtenue sous traitement, peut précéder un échappement biochimique (augmentation des transaminases / ALAT). La résistance virale est due à la sélection de virus variants (mutants) avec des substitutions d’acides aminés conférant une moindre sensibilité aux antiviraux. Claude EUGÈNE 24
- 25. HÉPATITE VIRALE B Réponse au traitement : comment la définir ? B) REPONSE SEROLOGIQUE Ag HBe - Perte de l’Ag HBe - Séroconversion HBe (apparition en plus de l’anti-HBe) Ag HBs - Perte de l’Ag HBs - Séroconversion HBs (apparition en plus de l’anti-HBs) Claude EUGÈNE 25
- 26. HÉPATITE VIRALE B Réponse au traitement : comment la définir ? C) REPONSE BIOCHIMIQUE Normalisation des transaminases ALAT 1) < 40 UI/ml Au minimum 1 dosage X 3 mois X 1 an (des élévations transitoires de l’ALAT sont possibles la 1ère année, obligeant à poursuivre la surveillance, au moins 2 ans après la dernière augmentation des ALAT) ……………………………………………..………………………….…………………………………….. 1) Alanine aminotransferase Claude EUGÈNE 26
- 27. HÉPATITE VIRALE B Réponse au traitement : comment la définir ? D) REPONSE HISTOLOGIQUE Diminution de l’activité histologique > 2 points Sans aggravation de la fibrose Claude EUGÈNE 27
- 28. HÉPATITE VIRALE B Qui traiter ? (1/2) : Principales indications 1) • Malades (Ag HBe + ou -) avec : - ADN viral B > 2000 UI/ml - ALAT > N 2) et/ou nécro-inflammation > modérée / fibrose • ADN > 2000 UI/ml et > 9 kPa 3) ou, si ALAT = N ou < 5 N, > 12 kPa •ADN > 2000 UI/ml et lésions histologiques > modérées • ADN > 2000 UI/ml + antécédent familial de cirrhose ou de CHC 4) • ADN VHB > 20 000 UI/ml et ALAT > 2 N • ADN > 20 000 UI/ml, HBe +, > 30 ans • Cirrhose : ADN détectable , quel que soit le taux / ALAT élevées ou pas ………………………………………………………………………..………………………… 1) Réf. principale : Vlachogiannakos J, Papatheodoridis GV. Hepatitis B : who and when to treat ? Liver international 2018;38(Suppl. 1):71-78. 2) N # 40 UI/ml. 3) Elastométrie (Fibroscan*). 4) Carcinome hépatocellulaire. Claude EUGÈNE 28
- 29. HÉPATITE VIRALE B Qui traiter ? (2/2) : Autres indications 1) • Hépatite aiguë sévère avec coagulopathie • Transplantation du foie • Co-infection Delta ave ADN régulièrement > 2000 UI/ml • Co-infection VIH 2) • Co-infection VHC 3) et traitement par anvi-viraux directs • Professionnels de santé et ADN viral B > 200 UI/ml • Grossesse 3ème trimestre et ADN viral B > 200 000 UI/ml 4) •Ag HBs (+) et chimiothérapie ou immunosuppresseurs 5) •Manifestation extra-hépartiques du virus B ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1) Réf. principale : Vlachogiannakos J, Papatheodoridis GV. Hepatitis B : who and when to treat ? Liver international 2018;38(Suppl. 1):71-78. 2) Virus de l’immunodéficience humaine 3) Virus de l’hépatite C 4) Ou Ag HBs > 4 log10 /ml 5) Et anti-HBc à haut risque de réactivation Claude EUGÈNE 29
- 30. HÉPATITE VIRALE B Si non traités 1) : quel rythme de surveillance ? • Ag HBe (+) < 30 ans 3 à 6 mois • Ag HBe (-) ADN < 2000 UI 6 à 12 mois • Ag HBe (-) ADN > 2000 UI - tous les 3 mois pendant 1 an - puis tous les 6 mois ……………………………………………………….. 1) Ne remplissant pas, actuellement, les critères d’un traitement (cf diapo précédente) Claude EUGÈNE 30
- 31. HÉPATITE VIRALE B Traitement : deux stratégies (2/2) A) INTERFERON PEGYLE alpha 1) 2) Pourquoi ? Traitement de durée définie (48 semaines) Induction d’un contrôle immunologique au long cours Inconvénients - Réponse variable - Contre-indications - Effets secondaires Sélection des patients +++ - Critères d’éligibilité fonction du patient, du stade, du virus - D’autres refusent B) ANALOGUES Voir le tableau plus bas (après celui pour l’interféron) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1) Principale référence : Vigano M, Grossi G, Loglio A et al. Treatment of hepatitis B: is there still a role for interferon ? Liver international 2018;38(Suppl. 1):79-83 2) Voir aussi le tableau plus bas Claude EUGÈNE 31
- 32. HÉPATITE VIRALE B Claude EUGÈNE 32 Interféron pegylé Intérêt Contrôle immunologique Traitement de durée définie Voie d’administration Sous-cutanée Durée 48 semaines Tolérance Souvent mauvaise Sécurité à long terme Rare persistance d’effets secondaires (psychiatriques, neurologiques, endocrinologiques) Contre-indications Nombreuses : décompensation hépatique, co-morbidités Supression virale Modérée Perte de l’Ag HBe Modérée, fonction du profil initial Perte de l’Ag HBs Variable, fonction du profil initial (> aux analogues) Rechutes à l’arrêt Faible en cas de réponse 6 à 12 mois après l’arrêt Règles d’arrêt précoce Oui Risques de résistance Non
- 33. HÉPATITE VIRALE B Claude EUGÈNE 33 Analogues à haute barrière de résistance (ETV 1, TDF 2 , TAF 3) Intérêt Contrôle la progression de l’hépatite Inhibition de la réplication virale Voie d’administration Orale Durée Longue, jusqu’à perte de l’Ag HBs Arrêt après quelques années : cas sélectionnés Tolérance Excellente Sécurité à long terme Bonne (rein et os avec certains analogues ?) Contre-indications Non. Ajustement de la dose si filtration glomérulaire < 50 ml/mn sauf pour TAF Supression virale Forte Perte de l’Ag HBe Faible la 1ère année, augmente avec le temps Perte de l’Ag HBs Faible, augmente avec le temps chez sujets Ag HBe + 4 Rechutes à l’arrêt Risque modérée si traitement de consolidation après séroconversion HBe, élevé si hépatite Ag HBe (-) Règles d’arrêt précoce Non Risques de résistance Minime ou nul (jusqu’ici pour TDF et TAF) 1) Entecavir, 2) tenofovir, 3) tenofovir alafenamide; 4) Très faible chez sujet Ag HBe (-)
- 34. HÉPATITE VIRALE B INTERFERON Claude EUGÈNE 34
- 35. HÉPATITE VIRALE B Monothérapie par interféron pegylé (PEG) INDICATIONS Traitement initial possible d’hépatites Ag HBe (+) ou (-), Hépatites minimes à modérées, Cas sélectionnés de cirrhose compensée 1) DURÉE 48 semaines 2) RÉPONSES Cf diapo suivante ……………………………………..………….…………………………… 1) Cirrhoses compensées sans hypertension portale 2) Un traitement prolongé > 48 semaines peut être envisagé pour des cas sélectionnés d’hépatite Ag HBe (-). Claude EUGÈNE 35
- 36. HÉPATITE VIRALE B Monothérapie par interféron pegylé (PEG) RÉPONSES Ag HBe (+) - Succès 1) 6 mois après arrêt du traitement : 20-30% Ag HBe (-) 2) - Réponse biochimique : 6 mois 60%; 3 ans : # 30% - Réponse virologique : 6 mois # 40%; 3 ans : < 30% …………………………………………………….…………… 1) Succès = perte de l’Ag HBe et ADN < 2000 UI/ml. Chez ces patients, l’Ag HBe est toujours (-) à 3 ans chez > 80%. Perte de l’Ag HBs après 12 mois de traitement : 3-7%, puis 30% au bout de 3 ans de suivi. Séroréversions vers Ag HBs (+) : rares. 2) PEG moins efficace sur les génotypes sur hépatites Ag HBe (-), génotypes D et E : 20% (30% génotype C) Claude EUGÈNE 36
- 37. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé (PEG) : quelle surveillance ? RYTHME ? Pendant le traitement : 3, 6, 12 mois Après le traitement: 6, 12 mois et régulièrement COMMENT ? * ALAT 1), ADN viral B, Ag HBs quantitatif / NFS-plaquettes / TSH * Si Ag HBe (+) : surveiller séroconversion * Si réponse virologique : continuer surveillance (années) => Risque de « rechute » sous forme d’hépatite chronique Ag HBe (-) ou même de séroréversion HBe (+); ce risque diminue avec le temps. => Ag HBs tous les ans. Si Ag HBs (-) rechercher anti-HBs ……………………………………………………………………..…………………… 1) Transaminase, alanine aminotransferase (ex SGPT) Claude EUGÈNE 37
- 38. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé (PEG) : « stopping rules » 1) a) Patient Ag HBe (+) a) à 12 semaines de traitement Génotype B et C: Ag HBs > 20 000 UI/ml Génotype A et D: pas de baisse Ag HBs b) à 24 semaines de traitement Génotypes A-D: Ag HBs > 20 000 UI/ml b) Patient Ag HBe (-) Génotype D, après 12 semaines : Pas de baisse de l’Ag HBs + baisse < 2 log10 UI/ml ADN viral B ………………………………………………………………………………………………… 1) Quand arrêter le traitement Claude EUGÈNE 38
- 39. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé (PEG) et perte de l’Ag HBs Attention Continuer le dépistage du carcinome hépatocellulaire (CHC) s’il existait au départ des facteurs de risque Claude EUGÈNE 39
- 40. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé : Quels prédicteurs d’une réponse ? Ils sont envisageables sous 4 angles a) Viraux b) En rapport avec l’hôte c) Avant le traitement d) Pendant le traitement Claude EUGÈNE 40
- 41. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé : Quels prédicteurs d’une réponse ? A) Au départ chez un sujet Ag HBe (+) - Virémie faible (et taux d’Ag HBs) - ALAT > 2 à 5 N - Age jeune - Sexe féminin - Génotypes A et B > génotypes C et D - Forte activité sur la biopsie hépatique ………………………………………………………………………………..……….. Référence principale : Vigano M, Grossi G, Loglio A et al. Treatment of hepatitis B: is there still a role for interferon ? Liver international 2018;38(Suppl. 1):79-83 Claude EUGÈNE 41
- 42. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé : Quels prédicteurs d’une réponse ? B) Pendant le traitement - Prédicteur de séroconversion Ag HBe => anti-HBe (PPV : 50%) Ag HBs < 1500 UI/ml à la semaine 12 - Très faible possibilité de séroconversion HBe : . génotypes B et C : Ag HBs > 20 000 UI/ml . génotypes A et D : pas de baisse de l’Ag HBs . tous génotypes : Ag HBs > 20 000 UI/ml à semaine 24 - Génotype D, Ag HBe (-), pas de baisse de l’Ag HBs et baisse d’ADN < 2 log10 UI/ml à 12 semaines : non réponse 100% => arrêt traitement ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Référence principale : Vigano M, Grossi G, Loglio A et al. Treatment of hepatitis B: is there still a role for interferon ? Liver international 2018;38(Suppl. 1):79-83 Claude EUGÈNE 42
- 43. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé : quels résultats ? - Suppression réplication virale et ALAT = N : # 30% - Parmi ceux-ci, à long terme (traitement arrêté) : disparition Ag HBs = 30%-50% - Effets secondaires nets mais acceptables 30% (syndrome grippal, céphalées, myalgies, fatigue, perte de poids, dépression, perte de cheveux, neutropénie, thrombopénie) Claude EUGÈNE 43
- 44. HÉPATITE VIRALE B Interféron pegylé : quel futur ? Chez des malades traités par analogues (entecavir, tenofovir), des stratégies d’ « add-on » ou de « switch » pourraient augmenter l’effet sur l’Ag HBs chez des patients sélectionnés Claude EUGÈNE 44
- 45. HÉPATITE VIRALE B ANALOGUES Claude EUGÈNE 45
- 46. HÉPATITE VIRALE B Claude EUGÈNE 46 AnaloguesPUISSANTS (ETV 1, TDF 2 , TAF 3) /(Rappel) Intérêt Contrôle la progression de l’hépatite Inhibition de la réplication virale Voie d’administration Orale Durée Longue, jusqu’à perte de l’Ag HBs Arrêt après quelques années : cas sélectionnés Tolérance Excellente Sécurité à long terme Bonne (rein et os avec certains analogues ?) Contre-indications Non. Ajustement de la dose si filtration glomérulaire < 50 ml/mn sauf pour TAF Supression virale Forte Perte de l’Ag HBe Faible la 1ère année, augmente avec le temps Perte de l’Ag HBs Faible, augmente avec le temps chez sujets Ag HBe + 4 Rechutes à l’arrêt Risque modérée si traitement de consolidation après séroconversion HBe, élevé si hépatite Ag HBe (-) Règles d’arrêt précoce Non Risques de résistance Minime ou nul (jusqu’ici pour TDF et TAF) 1) Entecavir, 2) tenofovir, 3) tenofovir alafenamide; 4) Très faible chez sujet Ag HBe (-)
- 47. HÉPATITE VIRALE B Quels analogues proposer ? Administration au long cour d’analogues puissants 1) • Entecavir (ETV) • Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) • Tenofovir alafenamide (TAF) En monothérapie Quelle que soit la sévérité de la maladie du foie ……………………………………………………………………………………………………..……………… 1) Analogues à haute barrière de résistance. Sont non recommandés pour le traitement de l’hépatite chronique : lamivudine (LAM), adefovir dipivoxil (ADV), telbivudine (TBV) Claude EUGÈNE 47
- 48. HÉPATITE VIRALE B Analogues : quelle efficacité ? quelle tolérance ? 1) Un traitement à long terme est souvent nécessaire pour obtenir une suppression virale durable. Il est recommandé d’utiliser d’emblée les analogues nucléos(t)idiques de 2ème génération, les plus puissants et ayant les meilleurs profils de résistance : Entecavir (ETV) 2) , Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) et Tenofovir alafenamide (TAF) 3). Ces médicaments sont dans l’ensemble très efficaces (ADN négatif à des périodes allant de 1 à 3 ans : 90 à 98%) et bien tolérés. ETV et TDF ont une excrétion rénale importante et une adaptation de dose est requise si le filtration glomérulaire estimée est < 50 ml/mn/1,73m2. Adaptation non nécessaire pour le TAF (jusqu’à >15 ml/mn ou hémodialyse) 4). • Néphrotoxicité possible, mais rare, avec ETV et TDF (< 10%). • Toxicité osseux possible, mais rare, avec TDF. ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………… 1) Réf. principale : Buti M, Riveiro-Barciela M, Esteban R. Long-term safety and efficacy of nucleo(t)side analogue therapy in hepatitis B. Liver international 2018;38(Suppl. 1):84-89. 2) Analogue nucléosidique 3) Analogues nucléotidiques 4) L’EASL recommande le TAF plutôt que le TDF: chez les patients > 60 ans, si os malade ou à risque (corticoïdes…), si altération rénale : < 60 ml/mn/1,73m2), albuminurie, phosphatémie basse, hémodialyse. En France : ATU nominative (février 2018) Claude EUGÈNE 48
- 49. HÉPATITE VIRALE B Patients sous analogues : quelle bilan initial ? 1) NFS-plaquettes 2) Bilan hépatique 3) Bilan rénal 1) (clairance de la créatinine, phosphate sérique) 4) ADN viral B (méthode quantitative sensible) …………………………………………………………………………………………. 1) Si clairance de la créatinine < 50 ml/mn : adapter les doses d’entecavir ou de tenofovir (pour le tenofovir alafenamide < 15 ml/mn) Claude EUGÈNE 49
- 50. HÉPATITE VIRALE B Quand choisir l’entecavir (ETV) ou le tenofovir alafenamide (TAF) plutôt que le tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ? Age > 60 ans Risque osseux Ostéoporose, fracture, corticoïdes… Atteinte rénale Filtration glomérulaire estimée < 60 ml/mn/1,73m2 Protéinurie > 30 mg/24h Phosphatémie < 25 mg/l Claude EUGÈNE 50
- 51. HÉPATITE VIRALE B Comment éviter et gérer les résistances ? Utiliser des analogues à haute barrière de résistance Veiller à la compliance Tenir compte des résistances croisées Adapter le traitement dès que l’échec viral est confirmé Claude EUGÈNE 51
- 52. HÉPATITE VIRALE B Patients sous analogues : quelle surveillance ? Dosages réguliers ALAT, ADN viral B Tous les 3-4 mois pendant 1 an Tous les 6 mois ensuite Ag HBs tous les ans si ADN virus B (-) Surveillance rénale a) Estimation périodique : filtration glomérulaire, phosphatémie - Avec tous les analogues, si risque d’atteinte rénale - Sinon, en cas de prise de Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) b) Patients sous TDF - et risque rénal ou osseux : envisager switch pour Entecavir ou Tenofovir alafenamide 1) ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………… 1) En fonction d’une éventuelle exposition antérieure à la lamivudine (ATU en France début 2018) Claude EUGÈNE 52
- 53. HÉPATITE VIRALE B Patients sous analogues : ne pas oublier le CHC 1) ! Bien que son incidence diminue, le risque persiste ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1) Carcinome hépatocellulaire : cirrhose et autres patients à risque : échographie semestrielle Claude EUGÈNE 53
- 54. HÉPATITE VIRALE B Analogues : quant les arrêter ? (Introduction) Entecavir et tenofovir Suppression virale : presque tous les patients Traitement prolongé ou à vie habituellement nécessaire • Pas de consensus parfait entre les 3 guidelines les plus importantes (Cf tableau plus bas puis une synthèse d’après l’EASL) • Taux élevé de rechute après l’arrêt (en particulier au cours de l’hépatite Ag HBe (-) ) • Perte de l’Ag HBs rare et tardive 1) • Arrêt et cirrhose = risque +++ (décompensation et décès) ……………………………………………………………………….……………………………………………. 1) a) Ag HBe (+) au départ : perte de l’Ag HBs = 10-12% après 5-8 ans de traitement. b) Ag HBe (-) au départ : perte de l’Ag HBs rare = < 1-2% après 5-8 ans de traitement) Claude EUGÈNE 54
- 55. HÉPATITE VIRALE B : ARRÊT DES ANALOGUES 1) Claude EUGÈNE 55 Guidelines Ag HBe (+) Ag HBe (-) EASL 2017 2) - Perte Ag HBs (y compris cirrhose compensée) - HBe séroconversion 1 an de consolidation ADN viral B = 0 (pas de cirrhose) - Perte Ag HBs (y compris cirrhose compensée) - Après > 3 ans ADN = 0 (pas de cirrhose, surveillance +++) AASLD 2016 2) - Perte Ag HBs (y compris cirrhose compensée) - HBe séroconversion 1 an de consolidation ADN viral B = 0, ALAT = N (pas de cirrhose) - Perte Ag HBs (y compris cirrhose compensée) APASL 2015 2) - HBe séroconversion 1 à 3 ans de consolidation ADN viral B = 0, ALAT = N (Y compris cirrhose compensée avec surveillance +++) - Séroconversion HBs - Perte Ag HBs + 12 mois de TT 3) - > 2 ans de TT, ADN (-) x 3 fois à 6 mois d’intervalle. Ces 3 options sont possibles si cirrhose compensée,, mais surveillance +++ 1) D’après Marciano S, Gadano A. Why not to stop antiviral treatment in patients wit chronic hepatitis B. Liver Int 2018;38(Suppl. 1):97-101. 2) European Association for the Study of the Liver / American Association for the Study of Liver Diseases / Asian Pacific Association for the Study of the Liver. 3) Traitement
- 56. HÉPATITE VIRALE B Analogues : quant les arrêter ? 1) (Synthèse) 1) Après perte de l’Ag HBs +/- séroconversion HBs (anti-HBs = +) Y compris cirrhose compensée (avec surveillance +++) 2) Après séroconversion HBe stable (Ag HBe + => Ag HBe - et anti-HBe + ) ADN viral B indétectable > 12 mois de traitement de consolidation (1 à 3 ans selon les guidelines) Surveillance régulière après l’arrêt de l’analogue Pas de cirrhose 3) Ag HBe (-) : patients non cirrhotiques sélectionnés Suppression virale à long terme (> 3 ans) Pas de cirrhose Possibilité d’une surveillance biologique rapprochée ………………………………………………………….…………………………..……………………………………. 1) Réf. principale : EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection J Hepatol 2017;67:370-398. Claude EUGÈNE 56
- 57. HÉPATITE VIRALE B Analogues : quant les combiner ? 1) Analogues puissants pas de combinaison d’emblée 2) Si suppression virale incomplète (chez un patient compliant) : ADN viral en plateau sous ETV ou TDF/TAF 1) => soit switch (changement pour l’autre analogue) => soit add on (ajout de l’autre) ………………………………………………………….………………………… 1) Analogues à haute barrière de résistance : entecavir (ETV), tenofovir disoproxil fumarate (TDF), tenofovir alafenamide (TAF). Claude EUGÈNE 57
- 58. HÉPATITE VIRALE B Cirrhose décompensée : que faire ? Interféron contre-indiqué Traitement immédiat par un analogue puissant 1) (quel que soit le taux de l’ADN viral B) Envisager une transplantation Effets secondaires possibles (rares) : (Acidose lactique, insuffisance rénale) ……………………………………………………………………….……. 1) Analogues à haute barrière de résistance : entecavir (ETV), tenofovir disoproxil fumarate (TDF), tenofovir alafenamide (TAF). Claude EUGÈNE 58
- 59. HÉPATITE VIRALE B Cirrhose décompensée et transplantation (TH) AVANT TH Interféron contre-indiqué Traitement par un analogue puissant (AN) 1) APRES TH AN + immunoglobuline anti-VHB (HBIG) 2) ……………………………………………………………………………..……. 1) Analogues à haute barrière de résistance : entecavir (ETV), tenofovir disoproxil fumarate (TDF), tenofovir alafenamide (TAF). 2) Arrêt envisageable si le risque de réactivation est faible Claude EUGÈNE 59
- 60. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers Hépatite aiguë sévère Manifestations extra-hépatiques Co-infection Delta Co-infection VIH 1) Co-infection VHC 2) Grossesse Enfant Professionnel de la santé Immunosuppression et chimiothérapie Dialyse et transplantation rénale ……………………………………………………………………………..……. 1) Virus de l’immunodéficience humaine 2) Virus de l’hépatite C Claude EUGÈNE 60
- 61. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 1) HÉPATITE AIGUË SÉVÈRE 1) Si : - coagulopathie - évolution prolongée => Traiter avec un analogue => Envisager transplantation hépatique …………………………………………………………… 1) > 95% des adultes faisant une hépatite aiguë B guérissent spontanément (sans traitement). Claude EUGÈNE 61
- 62. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 2) MANIFESTATIONS EXTRA-HEPATIQUES - Interféron contre-indiqué si mécanisme immunologique - Si réplication virale => traitement par analogue Claude EUGÈNE 62
- 63. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 3) CO-INFECTION DELTA - Interféron pegylé (PEG) > 48 semaines - Si réplication virale B envisager analogue Claude EUGÈNE 63
- 64. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 4) CO-INFECTION VIH - Traitement anti-rétroviral quel que soit le taux de CD4 - Ce traitement doit comporter TDF 1) ou TAF 2) (qui sont également actifs contre le virus B) …………………………………………………………… 1) Tenofovir disoproxil fumarate 2) Tenofovir alafenamide Claude EUGÈNE 64
- 65. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 5) CO-INFECTION VHC 1) Traitement VHC par DAA 2) : risque réactivation VHB Si critères traitement VHB présents => analogues Ag HBs (+) : surveiller > 12 semaines après DAA Ag HBs (-) Ac anti-HBc (+) : surveiller si ALAT > N …………………………………………………………….. 1) Virus de l’hépatite C 2) Direct Acting Antivirals Claude EUGÈNE 65
- 66. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 6) GROSSESSE 3 points à envisager : Avant / Pendant / Transmission mère enfant A) AVANT UNE GROSSESSE => Peu de fibrose : traiter après la grossesse => Fibrose importante ou cirrhose : traitement immédiat Quel traitement ? - Interféron 1): . peut être tenté avant une grossesse (durée définie : 48 semaines) . contraception nécessaire - TDF 2) . excellent profil de résistance . pourrait être poursuivi en cas grossesse (sécurité bien évaluée)… B) GROSSESSE Ag HBs au 1er trimestre => Peu de fibrose : traitement non urgent => Fibrose avancée et cirrhose : traiter (si besoin « switch » vers le TDF C) TRANSMISSION FOETO-MATERNELLE 3) ADN > 200 000 UI/ml ou Ag HBs > 4 log10 UI/ml => TDF 4) de semaine (S) 24-28, jusqu’à 12 S après accouchement (Allaitement permis si Ag HBs (+) ou sous TDF ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 1) .Contre-indiqué pendant grossesse (contraception nécessaire) 2) Tenofovir disoproxil fumarate 3) Explique la majorité des infections virales B chroniques 4) Dans la crainte d’une efficacité insuffisante de la séro-vaccination à la naissance en raison de la virémie élevée. La séro-vaccination réduit le risque de transmission péri-natale de > 30-90% à < 10 %. Claude EUGÈNE 66
- 67. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 7) ENFANT / ADOLESCENT - Evolution habituellement bénigne - Si critères de traitement => Interféron pegylé (PEG) ou => ETV 1), TDF 2), TAF 3) ………………………………………………………………… 1) Entecavir 2) Tenofovir disoproxil difumarate 3) Tenofovir alafenamide Claude EUGÈNE 67
- 68. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 8) PROFESSIONNEL DE SANTE - Si ADN > 200 UI/ml : proposer analogue (pour réduire le risque de transmission) Claude EUGÈNE 68
- 69. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 9) IMMUNOSUPPRESSION ET CHIMIOTHERAPIE Rechercher marqueurs du virus B a) Ag HBs (+) : traiter => ETV 1), TDF 2) ou TAF 3) b) Ag HBs (-) / anti-HBc (+): traiter si risque réactivation ……………………………………..………….…………………..………… 1) Entecavir 2) Tenofovir disoproxil difumarate 3) Tenofovir alafenamide Claude EUGÈNE 69
- 70. HÉPATITE VIRALE B Cas particuliers 10) DIALYSE ET TRANSPLANTATION RENALE Rechercher marqueurs du virus B - Si traitement nécessaire : ETV 1) ou TAF 2) - Transplantation prévue, Ag HBs (+): idem - Ag HBs (-), anti-HBc (+) : surveiller +++ …………………………………………………………….. 1) Entecavir 2)Tenofovir alafenamide Claude EUGÈNE 70
- 71. RÉFÉRENCES (1/2) Vigano M, Grossi G, Loglio A et al. Treatment of hepatitis B: is there still a role for interferon ? Liver Int 2018;38(Suppl. 1):79-83 Vlachogiannakos J, Papatheodoridis GV. Hepatitis B : who and when to treat ? Liver Int 2018;38(Suppl. 1):71-78. Buti M, Riveiro-Barciela M, Esteban R. Long-term safety and efficacy of nucleo(t)side analogue therapy in hepatitis B. Liver Int 2018;38(Suppl. 1):84-89. Marciano S, Gadano A. Why not to stop antiviral treatment in patients wit chronic hepatitis B. Liver Int 2018;38(Suppl. 1):97-101. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection J Hepatol 2017;67:370-398. Claude EUGÈNE 71
- 72. RÉFÉRENCES (2/2) Rajoriya N, Combet C, Zoulim F et al. How viral genetic variants and genotypes influence disease and treatment outcome of chronic hepatitis B. Time for an individualised approach ? J Hepatol 2017;67:1281-1297. Terrault NA, Bzowej NH, Chang KM et al. AASLD Guidelines for treatment of chronic hepatitis B. Hepatology 2016;63:261-283. Sarin SK, Kumar M, Lau GK et al. Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol Int 2016;10:1-98. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines : Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012;57:167-185. Claude EUGÈNE 72
