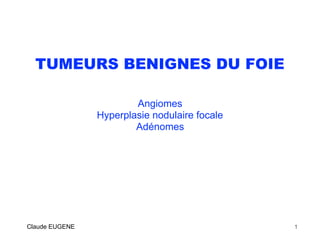
Tumeurs benignes du foie
- 1. TUMEURS BENIGNES DU FOIE Angiomes Hyperplasie nodulaire focale Adénomes Claude EUGENE 1
- 2. TUMEURS BENIGNES DU FOIE Découverte de plus en plus fréquente chez des patients souvent asymptomatiques en raison du développement des méthodes d’imagerie (échographie, scanner, IRM 1 ) 1) Imagerie par résonance magnétique Claude EUGENE 2
- 3. TUMEURS BENIGNES DU FOIE Mode de découverte Echographie abdominale (le plus souvent, autre imagerie plus rarement) Faite pour : - une gêne abdominale (souvent sans rapport avec la tumeur bénigne du foie) - des anomalies du bilan hépatique - tout autre cause, comme une infection urinaire Claude EUGENE 3
- 4. TUMEURS BENIGNES DU FOIE L’interrogatoire et l’examen clinique recherchent Eventuels antécédents tumoraux (personnels ou familiaux) Arguments en faveur d’un possible cancer - Troubles du transit récents, rectorragies - Altération de l’état général - Masse au niveau d’un sein… Arguments en faveur d’une maladie du foie - Consommation d’alcool - Usage de drogue, tatouages, - Notion d’ictère, d’hépatite, de cirrhose (crainte alors d’un cancer du foie) Fièvre, séjour à l’étranger, dysenterie Prise de pilule contraceptive 1) ou d’androgènes 2) 1) Notion importante dans le cadre des adénomes du foie 2) Favorise la survenue de tumeur hépatique bénigne ou maligne Syndrome métabolique - Obésité, diabète de type II, hypertension artérielle Notion importante au cours de certains adénomes, favorise le cancer Claude EUGENE 4
- 5. TUMEURS BENIGNES DU FOIE Ensuite : quelle imagerie complémentaire ? Une imagerie avec injection de produit de contraste • Echographie par une personne entraînée • Scanner - Surtout si l’on suspecte un cancer • IRM (++) - Moins accessible - N’irradie pas - Bonne caractérisation des lésions - Bon examen de seconde ligne si on suspecte une tumeur bénigne, en particulier chez un sujet jeune Claude EUGENE 5
- 6. TUMEURS BENIGNES DU FOIE Si le doute persiste => biopsie dirigée ou résection La décision doit être prise par une équipe multi-disciplinaire (hépatologue, chirurgien hépato-biliaire, radiologue, anatomo-pathologiste) C’est aussi cette équipe qui prendra en charge les rares complications des tumeurs bénignes du foie Claude EUGENE 6
- 7. ANGIOME Prévalence élevée Imagerie = environ 5%, autopsie = jusqu'à 20% Plus fréquent chez la femme A 30-50 ans Ration femme/homme : jusqu’à 6/1 Taille généralement réduite < 4 cm mais il y a des angiomes géants (10-20 cm) ceux-ci peuvent être symptomatiques : douleurs ; syndrome de Kasabach-Merrit (coagulopathie avec thrombopénie) Macroscopie Lésion rougeâtre-bleutée de < 3 cm (angiome capillaire) à 10 cm et plus (angiome caverneux ou géant) Tumeurs vasculaires, fibrose, thrombose et calcifications possibles Imagerie a) Forme typique : Echographie suffisante: < 3 cm, hyper-échogène, homogène, bien limitée, renforcement acoustique postérieur b Formes atypique : Imagerie avec injection de produit de contraste (échographie, scanner, IRM ++) : Prise de contraste en mottes périphériques suivie d’un renforcement central tardif L’IRM montre aussi avant injection : lésion typo-intense en T1, très hyper-intense en T2 Le coefficient apparent de diffusion est élevé Biopsie Rarement nécessaire Possible à condition d’avoir un peu de parenchyme hépatiquee sain entre la capsule du foie et la périphérie de l’angiome Conduite à tenir Habituellement pas de traitement particulier Chirurgie : très rarement (Syndrome de Kasabach Merrit…) La grossesse et la prise de pilule contraceptive sont autorisées Claude EUGENE 7
- 8. HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE 1) Prévalence élevée 2ème tumeur bénigne du foie après l’angiome Plus fréquent chez la femme A 35-50 ans Ration femme/homme : jusqu’à 9/1 Taille généralement réduite < 5 cm Le plus souvent solitaires; multiples = 20-30% des cas (en particulier dans Budd-Chiari, veinopathie portale obstructive télangiectasies héréditaires) Association possible à : des angiomes = 20%, des adénomes plus rarement Physiopathogénie et pathologie Prolifération hépatocellulaire secondaire à une malformation artérielle Cicatrice fibreuse centrale (qui peut manquer si lésion < 3 cm) avec vaisseaux dystrophiques Hépatocytes disposés en nodules, septa fibreux, possible prolifération ductulaire et cellules inflammatoires Taille stable avec le temps Imagerie Rappelle la pathologie Echographie : lésion habituellement légèrement hypo- ou iso-échogène, pseudo-capsule parfois et typiquement : artère centrale avec aspect en rayon de roue Imagerie, quelle qu’elle soit : - lésion homogène en dehors de la cicatrice centrale - légèrement différente du foie normal avant injection - rehaussement fort et homogène en phase artérielle - devant semblable au foie normal en phase portale et tardive C’est l’IRM qui montre le mieux la cicatrice centrale (hypo-intense en T1 avant injection, fortement hyper intense en T2 devenant hyper-intense en phase tardive avec un produit de contraste extra-cellulaire (accumulation dans le tissu fibreux) Claude EUGENE 8
- 9. HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE 2) Conduite à tenir Habituellement pas de traitement particulier Chirurgie : très rarement La grossesse et la prise de pilule contraceptive (PC) sont autorisées 1 Si le diagnostic est certain : pas de surveillance particulière 1) En cas de prise de PC une surveillance annuelle par imagerie (échographie) est recommandée pendant 2 à 3 ans Claude EUGENE 9
- 10. ADENOMES 1) Prévalence faible 10 fois moins fréquents que l’HNF (hyperplasie nodulaire focale) 0,007-0,012% de la population Terrain favorisant : glycogénoses Ia et III, syndrome métabolique 1) Plus fréquent chez la femme A 35-40 ans Ration femme/homme : 10/1 Rôle de l’usage prolongé de la pilule contraceptive (incidence x 30-40) possible régression à l’arrêt de la « pilule » Chez l’homme : rôle de l’usage d’anabolisants et d’androgènes Pathologie, histoire naturelle Proliférations hépatocytaires de différents types moléculaires (cf après) Lésions le plus souvent solitaires. Parfois pédonculées Taille variable : quelques mm à 30 cm Risque hémorragique et de cancérisation (rarement si < 5 cm) 1) Obésité, diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie Claude EUGENE 10
- 11. ADENOMES 2) Epidémiologie - Tumeur hormono-dépendante (estrogènes, androgènes) - Surtout chez la femme jeune - Incidence : 3/100000 Complications - Hémorragie : 15-20% - Cancérisations : 5%, le risque augmente avec la taille, d’où => résection des adénomes de taille > 5 cm Imagerie L’IRM est la meilleure méthode (cf tableau suivant) Elle permet souvent une caractérisation de l’adénome Elle permet souvent d’éviter la biopsie Claude EUGENE 11
- 12. Tableau 1 ADENOMES : IMAGERIE Claude EUGENE 12 ECHOGRAPHIE SCANNER IRM HNF1-alpha Hétérogène Hyperéchogène si stéatosique Centre anéchogène si saignement Bien délimité Renforcement périphérique Homogène souvent Hétérogène moins souvent Hypodense si stéatose Hyperdense si saignement perte de signal ‘on chemical shift’ rehaussement artériel modéré non persistant en phase tardive inflammatoire très hyper-intense en T2 signal + fort en périphérie persistant en phase tardive mutation beta-catenine heterogène pas de chute de signal ‘on chemical shift’ isointense en T1 et T2 fort rehaussement artériel et ‘washout’ retardé adénome télangiectatique variable Hypo ou isointense T1 hétérogène iso à hyper intense Hyperintense et rehaussement pesistant
- 13. ADENOMES 3) Grossesse - Une augmentation de taille est possible - Grossesse possible si lésion < 5 cm Surveillance échographique Claude EUGENE 13
- 14. ADENOMES 4) Risque de cancérisation - Sexe masculin - CTNNB2 mutation exon 3 (beta catenin) et aussi : - diabète - alcool - tumeur unique - fibrose au niveau du foie non tumoral Risque de saignement - Sonic Hedgehog activation histologique > 50% symptomatique > 10% Claude EUGENE 14
- 15. ADENOMES 5) Prise en charge / traitement - Homme : classification moléculaire peu intéressante car risque de cancérisation et destruction tumorale indiquée - Femme : la classification moléculaire peut aider à la prise en charge . adénome avec mutation HNFA1 = 40% des adénomes < 5 cm reconnaissables en IRM pas de risque de cancérisation . adénome > 5 cm = résection chirurgicale, mais peut être tempérée par classification moléculaire Arrêt pilule contraceptive et surveillance plusieurs mois… Claude EUGENE 15
- 16. ADENOMES 6) Classification moléculaire initiale 4 sous-groupes - Hepatocyte nuclear factor 1A (HNF1A) mutations Prédispose : adénomatose (> 10 adénomes) / stéatose - Janus kinase (JAK)/signal transduder and activator of transcription (STAT) mutations Adénomes inflammatoires - Cadherin-associated proteins beta1 (CTNNB1) exon 3, activating Beta-catenin Risque de cancérisation - Association phénotype inflammatoire/mutation CTNNB1, exon 3 (Beta-catenin) Classification récente 8 sous-groupes (voir tableaux ci-après) Claude EUGENE 16
- 17. Tableau 2 ADENOMES (a) Claude EUGENE 17 Définition moléculaire Inactivation HNF1A Beta-catenine activation faible JAK/STAT activation Beta-catenine activation Sonic Hedgehog activation pas de mutation Classification HNF1A 34% Beta-catenine exon 7/8 3% Inflammation 34% Beta-catenine exon 3 7% Sonic Hedgehog 4% Non classé 34% B-catenine exon 7/8 inflammation : 4% B-catenine exon 3 inflammation : 6% Facteurs de risque HNF1A germline Obésité Alcool Glycogénose Androgènes Maladie vasculaire du foie Obésité - Clinique Femme Adénomatose Tumeur unique Patient jeune Plus âgé 0 symptômes GGT et PAL S. inflammatoire Risque cancer Homme Tumeur unique Jeune Risque saignement -
- 18. Tableau 3 ADENOMES (b) Claude EUGENE 18 Définition moléculaire Inactivation HNF1A Beta- catenine activation faible JAK/STAT activation Beta-catenine activation Sonic Hedgehog activation pas de mutation Histologie Stéatose tumorale Microadénome Peu hémorragique Hémorragie Atypies cytologiques Cholestase Infiltrat inflam. Dilatation sinusoïdale Artères dystrophiques Stéatose non tumorale Atypies cytologiques Cholestase > 5 cm Hémorragies Stéatose non tumorale - Coloration Immunologique FABP (-) Glutamine synthase : faible SAA et CRP (+) Glutamine synthase (+) Quelques beta- catenine nucléaires (+) PGDS (+) -
- 19. REFERENCES 1. Nault J-C, Couchy G, Balabaud C et al. Molecular classification of hepatocellular adenoma associates with risk factors, bleeding, and malignant transformation. Gastroenterology 2017;152: 880-894. 2. Colombo M, Forner A, Ijzerman J et al. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumours J Hepatol 2016;65:386-398. 3. Marrero JA, Zhn J, Reddy KR ACG Clinical guideline: the diagnosis and management of focal liver lesions Am J Gastroenterol 2014;109:1328-1347. 4. Laumonier H, Bioulac-Sage P, Laurent C et al. Hepatocellular adenomas: magnetic resonance imaging features as a function of molecular pathological classification. Hepatology 2008;48:808-818. Claude EUGENE 19
